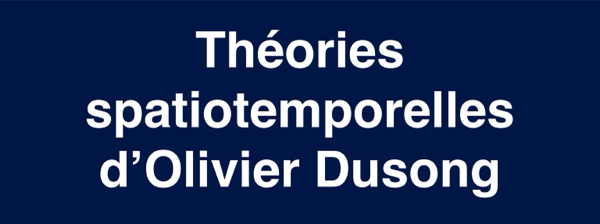Une particule peut-elle être partout ? L’expérience qui aurait validé Einstein

En 1930, Einstein voulait présenter un argument imparable contre une idée qui prenait de plus en plus d’importance dans les débats — l’interprétation de Bohr et de l’école de Copenhague du principe d’indétermination d’Heisenberg. Ce principe énonce qu’il est fondamentalement impossible de connaître simultanément la position et la vitesse d’une particule avec une précision absolue. Plus on cherche à mesurer précisément l’un de ces paramètres, plus l’autre devient flou.
Cela ne prouve pas nécessairement que la particule n’a pas de position et de vitesse bien définies, mais simplement que l’observation perturbe inévitablement le système au point de rendre ces informations inaccessibles avec une précision infinie. Bohr et ses collègues interprétèrent cependant cette indétermination comme une absence totale de réalité définie avant la mesure. Selon eux, une particule quantique n’existe pas dans un état précis tant qu’elle n’est pas observée : elle est décrite par une superposition d’états possibles, où elle se trouve simultanément dans plusieurs positions et vitesses à la fois. Ce n’est que l’acte de mesure qui “force” la particule à adopter une valeur bien définie, en provoquant l’effondrement de sa fonction d’onde. Ce modèle, aujourd’hui présenté comme un consensus scientifique inébranlable, reste la référence dominante en physique quantique. Pourtant, d’autres explications, moins connues mais tout aussi valables, existent et offrent des perspectives différentes sur la nature de la réalité quantique.
Mais je crois que l’idée de Copenhague a sans doute été exacerbée par les étranges résultats obtenus par l’expérience des fentes de Young, où une particule, telle qu’un électron, semblait passer simultanément par deux fentes, se comportant comme une onde, avant de “choisir” une seule position lorsqu’elle était mesurée. Les étrangetés observées dans cette expérience rendaient la théorie de Copenhague particulièrement séduisante et facile à accepter comme probablement vraie, sans qu’elle soit remise davantage en question.
C’est précisément cette interprétation qu’Einstein refusait. Pour lui, la particule possédait bien une réalité objective avant d’être mesurée, et l’observation ne faisait que révéler cette réalité. Einstein était convaincu que la mécanique quantique, dans sa forme actuelle, ne fournissait qu’une approximation de la réalité et qu’une description plus complète devrait rendre compte de la réalité physique sous-jacente de manière plus déterministe. Mais il ne remettait pas en cause le principe d’indétermination lui-même, il remettait plutôt en question l’interprétation de ce principe proposée par Bohr et ses collègues de Copenhague, qu’il trouvait insuffisante et contre-intuitive.
L’expérience de la boîte à particule d’Einstein
Dans une salle remplie des esprits les plus brillants de son époque, Einstein, prêt à défier le consensus, s’avança calmement vers ses collègues. Le ton posé, mais le regard déterminé, il s’apprêtait à livrer une nouvelle attaque contre l’interprétation de Copenhague.
« Messieurs, imaginez une boîte parfaitement scellée, contenant une particule quantique. Selon vous, tant que nous ne l’observons pas, cette particule n’a pas de position définie. Elle existerait dans une superposition d’états, étant simultanément partout et nulle part à la fois, occupante de tous les recoins à l’intérieur de cette boîte. »
Il laissa un instant de silence peser dans la pièce avant de poursuivre.
« Maintenant, divisons cette boîte en deux et envoyons chaque moitié à des kilomètres l’une de l’autre. Vous affirmez que, tant qu’aucune mesure n’a été faite, la particule ne se trouve ni dans l’une ni dans l’autre, qu’elle est dans une superposition des deux moitiés. Pourtant, si j’ouvre l’une des boîtes et n’y trouve rien, vous me dites que la particule aurait instantanément “choisi” sa place dans l’autre boîte, à cet instant précis ? »
Il marqua une pause, scrutant ses interlocuteurs, puis conclut d’un ton défiant :
« Ce n’est pas de la physique, c’est de la magie. La particule doit forcément avoir eu une position bien définie avant que nous ne l’observions. L’univers ne peut pas dépendre de notre simple regard. »
Bohr, assis en face de lui, croisa les bras et esquissa un sourire. Il connaissait bien cette obstination d’Einstein à défendre un réalisme objectif. Mais dans son esprit, la réponse était claire : en mécanique quantique, la réalité ne se fixe qu’au moment de l’observation.
Les débats allaient continuer, sans qu’aucun des deux hommes ne cède un pouce de terrain.
Einstein écoutait ses collègues exposer leur point de vue avec une patience feinte, les bras croisés, tapotant distraitement du doigt sur la table. Puis, il se redressa et, d’une voix calme mais ferme, reprit leur raisonnement à sa manière.
« Si je comprends bien, selon vous, tant que nous ne regardons pas, cette particule n’est ni ici, ni là-bas, mais dans un curieux entre-deux, une existence floue et indéfinie. » Il marqua une pause, laissant son regard balayer l’assemblée. « Et c’est seulement lorsque j’ouvre l’un des compartiments que, soudainement, la particule “décide” où elle se trouvait depuis le début ? »
Il laissa échapper un léger rire, plus ironique qu’amusé.
« Voilà donc le monde dans lequel vous voulez que nous vivions ? Un monde où la réalité attend sagement qu’un observateur daigne poser son regard sur elle pour exister pleinement ? Un monde où une particule peut être à deux endroits à la fois jusqu’à ce que l’on se donne la peine de vérifier ? »
Bohr, imperturbable, haussa les sourcils et répondit avec son calme habituel.
« Ce n’est pas que la particule “choisit” où elle est, Albert. C’est simplement que, tant que nous ne la mesurons pas, nous ne pouvons pas parler de sa position comme d’une réalité fixe. Nous ne faisons que décrire ce que la nature nous permet d’observer. »
Einstein secoua la tête, comme s’il entendait une absurdité évidente.
« Alors vous acceptez un univers où l’existence même des choses est suspendue à notre volonté de les regarder ? Cela me dépasse. »
Les discussions allaient se poursuivre encore longtemps, mais une chose était claire : l’interprétation de Copenhague et la vision réaliste d’Einstein ne pourraient jamais se rencontrer.
La théorie De Broglie-Bohm
Au fil des années, une autre théorie a émergé, mais elle est restée dans l’ombre de l’interprétation de Copenhague. Cette théorie, toujours pertinente selon de nombreux physiciens, est celle de Broglie-Bohm, ou théorie de l’onde pilote. Elle postule que les particules ont toujours une position définie, guidée par une onde pilote. Bien que débattue, elle demeure un sujet de réflexion important dans la sphère scientifique. On l’appelle aussi la mécanique bohmienne, et elle est aussi fascinante que perturbante, car elle remet en question l’interprétation standard de l’école de Copenhague, selon laquelle une particule n’a pas de position précise avant d’être mesurée. L’onde pilote propose une alternative radicale : si elle était démontrée un jour, elle pourrait prouver qu’Einstein avait, une fois de plus, raison.
Pourquoi est-il aujourd’hui encore impossible de savoir qui a raison ?
Mais voici toute la difficulté. Si je réalisais cette expérience aujourd’hui et que je constatais que la particule se trouve dans l’une des boîtes, et non dans l’autre, je pourrais conclure en faveur de la vision d’Einstein : la particule avait une position définie avant la mesure. Cependant, les partisans de l’école de Copenhague, comme Bohr, rétorqueraient que la particule était en superposition d’états et que c’est l’observation qui a fixé sa position.
Alors, qui aurait raison ? Pour ma part, le véritable problème est que chaque scientifique interprétera différemment une même réalité observée. Une théorie peut être conforme à l’observation, mais cela signifie-t-il pour autant qu’elle est juste ? Or, si deux théories opposées expliquent une même expérience, l’une des deux doit être incorrecte.
L’expérience imaginée par Einstein illustre parfaitement cette impasse : elle ne permettrait pas d’établir de certitude ni d’apporter une découverte décisive. Au contraire, elle met en évidence une faille fondamentale : il est possible de formuler deux théories contradictoires à partir d’une même observation. Autrement dit, même si nous réalisions cette expérience, elle ne trancherait pas la question. Pourtant, le simple fait que la théorie de l’onde pilote donne raison à Einstein devrait nous amener à remettre en question l’interprétation de Copenhague, souvent considérée comme établie, alors qu’elle va à l’encontre du bon sens.
Si l’expérience des boîtes quantiques d’Einstein n’a jamais été réalisée, comment pourrait-on départager ces théories autrement ? Et puisque cette expérience donnerait toujours le même résultat, cela signifie que ni la théorie de l’onde pilote ni celle de l’indétermination de Bohr n’ont été définitivement prouvées. Bien qu’opposées, elles restent toutes deux compatibles avec l’observation, mais cela ne suffit ni à les valider ni à les invalider.
S’il est impossible de trancher entre ces deux visions du monde et que, quelle que soit l’interprétation adoptée, les résultats expérimentaux restent identiques, alors l’expérience elle-même n’apporte aucune réponse définitive. C’est là, pour moi, le cœur du problème : comment choisir entre deux théories radicalement opposées si elles mènent aux mêmes résultats ? Si cette impasse persiste, ne devrions-nous pas revoir ces théories en profondeur et concevoir de nouvelles expériences capables de départager enfin le vrai du faux ?
Enfin, il me semble que si l’on réinterprète le principe d’indétermination d’Heisenberg à la lumière de la théorie de l’onde pilote, une conclusion radicalement différente émerge. Plutôt que d’y voir une preuve que les particules n’ont ni position ni vitesse définies avant la mesure, on pourrait y lire une simple limite expérimentale imposée par l’interaction entre l’instrument de mesure et le système observé. Dans cette perspective, l’indétermination ne reflèterait pas une absence de réalité sous-jacente, mais plutôt notre incapacité à accéder à cette réalité sans la perturber. Une telle lecture permettrait de réconcilier la physique quantique avec la physique classique, en restaurant une forme de déterminisme où les trajectoires des particules existent bel et bien, même si elles nous échappent en pratique. Pour moi, loin d’être une simple subtilité théorique, cette approche remettrait en cause l’idée que la nature est fondamentalement probabiliste et ouvrirait la voie à une nouvelle compréhension des lois fondamentales de l’univers.
Olivier Dusong
Article libre de droit avec mention obligatoire de la source : https://dichotomieresolue.jimdofree.com/