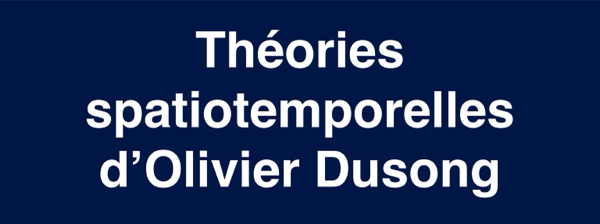La discorde du chat de Schrödinger

Introduction
Le célèbre Erwin Schrödinger scrutait le monde avec la précision d’un scientifique et la sensibilité d’un philosophe. En cette année 1935, assis à son bureau, il sentait une irritation sourde grandir en lui. Les fondements de la mécanique quantique, qu’il avait contribué à façonner, prenaient une tournure qu’il jugeait absurde. L’interprétation de Copenhague, portée par Niels Bohr et ses partisans, imposait une vision déroutante de la réalité : tant qu’un système quantique n’était pas observé, il ne possédait aucune valeur définie. Avant qu’un regard ne se pose sur lui, il demeurait dans un état trouble, une superposition d’alternatives, comme si le réel lui-même hésitait à se fixer.
Tout comme dans l’expérience des fentes de Young, où l’interprétation de Copenhague suggère que les particules sont à la fois des ondes et des corpuscules, l’idée de superposition soulevait un problème que Schrödinger ne pouvait ignorer.
Ce qui le dérangeait, ce n’était pas la dualité onde-corpuscule en elle-même, mais l’idée que l’acte d’observer puisse modifier la réalité physique d’un système.
Avec son expérience du chat, il cherchait à mettre en évidence cette absurdité. Selon lui, le fait que le chat soit vivant ou mort dépend uniquement du comportement de la particule radioactive, et non de l’observation que l’on en fait. L’acte d’observer ne pouvait en aucun cas influencer la réalité de l’événement.
Schrödinger rejetait fermement l’idée que l’observateur joue un rôle dans la détermination de l’état du monde quantique. En tant qu’esprit rationnel, il jugeait l’interprétation de Copenhague obscure et illogique. Pour lui, un système quantique devait avoir une réalité bien définie, indépendamment de toute observation.
Pour souligner l’absurdité de cette interprétation, Schrödinger imagina un paradoxe d’une grande habileté. Il fit une expérience de pensée en imaginant un chat enfermé dans une boîte. À l’intérieur, un mécanisme quantique était en jeu : un atome radioactif dont la désintégration libérerait une particule, brisant une fiole de poison, tuant ainsi le chat. Si l’atome ne se désintégrait pas, le chat resterait vivant. Mais voici le cœur du paradoxe : selon l’interprétation de Copenhague, tant que la boîte reste fermée, l’atome se trouve dans un état de superposition, à la fois désintégré et non désintégré, et donc, par effet domino, le chat serait simultanément vivant et mort.
Mais Schrödinger ne s’en tient pas à la simple superposition de l’atome. Il va plus loin, en introduisant l’idée que tous les éléments du système — l’atome, le mécanisme, la fiole de poison, et le chat — sont reliés entre eux, et que la superposition de l’atome s’étend à toute la chaîne d’événements qui en découle. Le bris de la fiole, la libération du poison, la vie ou la mort du chat : tout cela, dans cette logique, serait également dans un état de superposition. Le chat, ainsi, serait pris dans un enchevêtrement quantique absurde, étant à la fois vivant et mort, jusqu’à ce que l’on ouvre la boîte, et que l’acte d’observation permette de fixer la réalité.
Mais l’ironie du paradoxe de Schrödinger est profonde. Il ne croit pas une seconde à la possibilité d’une telle situation. En imaginant ce scénario absurde, il voulait mettre en évidence l’absurdité de l’interprétation de Copenhague. Selon lui, un chat ne pouvait pas, en toute logique, être simultanément vivant et mort. Si cette idée de superposition était vraie, cela impliquerait que toute la réalité observable serait, elle aussi, indéfinie, suspendue dans un état de superposition, jusqu’à ce qu’un acte d’observation vienne la fixer. Cette idée, pour Schrödinger, n’était rien d’autre qu’une farce, une dérision totale de ce que pouvait être la réalité.
L’accord d’Einstein avec la vision de Schrödinger
Albert Einstein, qui partageait ses doutes, ne put s’empêcher d’esquisser un sourire. « Crois-tu, Erwin, que la Lune disparaisse lorsque je détourne les yeux ? » La question était rhétorique. Pour Einstein, la réalité devait exister indépendamment de l’observateur. Un monde où les choses n’avaient d’état que sous le regard humain lui semblait une aberration.
Comme Schrödinger avec son chat, Einstein cherchait à montrer que cette interprétation semblait inapplicable aux objets macroscopiques et remettait en question l’idée d’une réalité indépendante de l’observateur. Il privilégiait une approche où les particules avaient des propriétés bien définies en permanence, indépendamment de toute mesure, ce qui l’a conduit à proposer, avec Podolsky et Rosen, le célèbre paradoxe EPR, destiné à mettre en défaut la vision probabiliste de la mécanique quantique.
Le chat de Schrödinger visait ainsi à mettre en lumière que, selon lui, tout comme selon d’autres, l’observateur ne pourrait avoir aucun pouvoir dans le processus de réduction de la fonction d’onde et que d’autres raisons devaient expliquer cela.
Bien qu’il ait tenté d’expliquer cela avec ses équations, Schrödinger se rendit vite compte qu’il n’y parvenait pas, ne parvenant pas à concilier la dualité onde-particule ni le rôle de l’observateur dans le processus quantique.
La théorie de l’onde pilote
Louis de Broglie, et plus tard David Bohm, proposèrent une nouvelle théorie, celle de l’onde pilote, où l’incertitude n’était qu’une illusion née de notre ignorance. Alors que Schrödinger voyait l’onde comme une réalité physique mais sans expliquer précisément comment la particule s’y intégrait, l’onde pilote a permis de concilier les deux aspects : selon l’interprétation de l’onde pilote, le chat de Schrödinger ne serait pas dans un état de superposition entre la vie et la mort jusqu’à ce qu’il soit observé. Au lieu de cela, la particule liée à l’appareil déclencheur, qui détermine la libération du poison, suit une trajectoire déterminée guidée par l’onde pilote. La particule ne se trouve pas dans un état de superposition, mais suit une évolution bien définie selon des règles précises. Le « chat » n’est donc jamais simultanément vivant et mort dans une superposition.
Son état résulte simplement du comportement déterministe des particules qui interagissent avec l’onde pilote. Dans cette approche, le hasard disparaissait. La particule n’était jamais suspendue dans un état flou, mais suivait une trajectoire bien définie. Le chat, lui aussi, voyait son sort déterminé bien avant qu’on ouvre la boîte. Il était soit mort, soit vivant, sans jamais avoir été cette chimère improbable que décrivait l’école de Bohr de Copenhague. Bien que cette approche ait été quelque peu oubliée, elle reste aujourd’hui encore une théorie alternative solide qui s’oppose à l’école de Copenhague et qui pourrait apporter les explications que l’interprétation de Copenhague n’est pas en mesure d’apporter.
L’interprétation de l’onde pilote résout le paradoxe du chat de Schrödinger en éliminant l’indétermination quantique. Le système reste déterministe à tout moment, et la question de la superposition d’états macroscopiques comme dans l’interprétation de Copenhague ne se pose pas, car l’onde pilote dirige les particules vers des résultats concrets et observables à tout moment.
L’hypothèse des univers parallèles
Plus tard une autre hypothèse, bien plus vertigineuse, commença à émerger. Et si, au lieu de choisir un état unique, l’univers lui-même se dédoublait à chaque instant ?
Hugh Everett proposa une interprétation encore différente, aussi troublante que fascinante : celle des mondes multiples, aujourd’hui connue sous le nom de théorie des univers parallèles ou du multivers.
Selon lui, lorsqu’un événement quantique se produit, toutes les possibilités se réalisent, mais dans des réalités parallèles distinctes. Dans un monde, l’atome se désintègre et le chat meurt. Dans un autre, l’atome reste intact et l’animal survit.
Dans le cas du chat, plutôt que d’être simultanément vivant et mort dans un état de superposition jusqu’à l’observation, Everett suggère que lorsque l’observation a lieu, l’univers se divise en plusieurs branches : dans une branche, le chat est vivant, et dans l’autre, il est mort. Chaque branche correspond à une réalité différente, mais chaque version de l’univers continue d’exister indépendamment. Le processus d’observation n’entraîne donc pas un effondrement de la fonction d’onde, mais plutôt la séparation de l’univers en multiples versions qui reflètent les différentes issues possibles.
Cette interprétation élimine la notion d’un effondrement de la fonction d’onde et reste déterministe, mais elle introduit une vision radicalement différente du rôle de l’observateur, suggérant que tous les résultats possibles d’un événement quantique existent simultanément, mais dans des univers distincts. Elle reste cependant non vérifiée à ce jour, bien que fascinante pour les fans de science-fiction.
La fuite infructueuse de l’école de Copenhague
Face au paradoxe du chat de Schrödinger, l’école de Copenhague chercha à en minimiser la portée en affirmant que la mécanique quantique ne concernait que les systèmes microscopiques. Selon cette vision, l’état de superposition ne s’appliquerait réellement qu’aux particules subatomiques, et non aux objets macroscopiques comme un chat. Un système quantique tel que celui déterminant la libération du poison serait inévitablement « perturbé » par son interaction avec l’environnement, ce qui provoquerait la décohérence et ferait disparaître toute superposition à notre échelle.
Ainsi, bien que le chat puisse théoriquement être à la fois vivant et mort, cette dualité resterait imperceptible à cause de la décohérence. Mais à y regarder de plus près, cette contre-argumentation semble fragile. Elle oublie un élément essentiel : le système qui libère ou non la fiole de poison est entièrement quantique. Comme une cascade inéluctable, la mécanique quantique s’enchaîne, de la particule à l’appareil déclencheur, puis au destin du chat. Chaque étape est régie par les lois du monde quantique, et la superposition ne disparaît pas par un simple tour de passe-passe théorique.
Ainsi, l’argument de la décohérence avancé par l’école de Copenhague ne suffit pas à enterrer le paradoxe du chat de Schrödinger. Au contraire, ce dernier conserve toute sa force, malgré les nombreuses incompréhensions qui persistent encore aujourd’hui. Beaucoup pensent, à tort, que la décohérence suffit à balayer l’expérience de pensée, alors qu’elle ne répond pas à la question fondamentale soulevée par Schrödinger.
En ignorant cet enchaînement inexorable de causes et d’effets, l’école de Copenhague a manqué l’essence même du problème. En invoquant la décohérence, elle passe à côté du véritable enjeu du paradoxe.
Conclusion scientifique du chat
Bien loin d’être résolu, le dilemme du chat de Schrödinger continue de mettre en lumière les tensions et les limites de l’interprétation de Copenhague. Il maintient un pied dans la porte de cette interprétation, l’empêchant de se refermer complètement sur elle-même, rappelant que la théorie majoritairement retenue laisse plus de questions ouvertes que de réponses définitives. D’autres anciennes théories alternatives, tout aussi valables et peut-être même plus cohérentes, ont été reléguées dans des tiroirs, prêts à se rouvrir à tout moment pour offrir un jour une compréhension plus cohérente des mystères de l’expérience des fentes de Young et de la nature même de la réalité. Le paradoxe du chat, en mettant en question la relation entre l’observateur et la réalité, invite à repenser ces idées longtemps oubliées, qui pourraient aujourd’hui être remises à jour à la lumière de nos connaissances accrues.
Olivier Dusong
Cet article est libre de droit sous réserve de mentionner la source : https://dichotomieresolue.jimdofree.com/