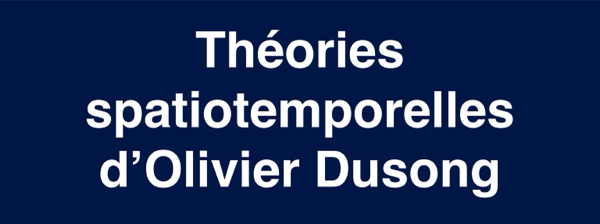Découverte de l’univers en expansion par le redshift
En 1929, l’astronome Hubble observa que la lumière des galaxies lointaines présentait un spectre de lumière qui se décalait vers le rouge, un phénomène appelé redshift.
Le redshift et l’effet Doppler
Ce redshift est comparable à l’effet Doppler, qui se produit lorsqu’une source d’ondes (comme un son ou de la lumière) se déplace par rapport à un observateur. Il est facile à comprendre avec un exemple sonore. Imaginons une ambulance qui passe à proximité. Lorsque l’ambulance s’approche, le son de la sirène semble de plus en plus aigu, c’est-à-dire avec une fréquence plus élevée. Cela se produit parce que les ondes sonores sont comprimées dans la direction du mouvement de la source vers l’observateur. Une fois que l’ambulance passe et s’éloigne, le son devient plus grave, car les ondes, au lieu d’être compressées, sont dilatées, ce qui abaisse leur fréquence et rend le son plus grave.
L’effet Doppler permet ainsi de savoir si un objet qui émet des ondes en direction d’un observateur s’approche de lui ou s’en éloigne.
Le redshift de la lumière
Il en est de même avec la lumière. Si une source de lumière, comme une galaxie, se rapproche de nous, les ondes lumineuses sont comprimées, ce qui crée un décalage vers le bleu, c’est-à-dire que la lumière devient plus bleue. En revanche, si la source s’éloigne de nous, les ondes lumineuses sont étendues, ce qui entraîne un décalage vers le rouge, c’est le redshift, rendant la lumière plus rouge.
L’interprétation de Hubble
Ce décalage vers le rouge, ou redshift, a été observé par Edwin Hubble dans les années 1920 et lui a permis de déduire que pratiquement toutes les galaxies s’éloignent de nous. Plus le redshift est important, plus la galaxie s’éloigne rapidement.
Hubble a interprété ce décalage vers le rouge des galaxies comme un signe qu’elles s’éloignent de nous. Plus une galaxie est éloignée, plus le décalage vers le rouge est important, ce qui suggère que l’univers est en expansion.
Cette observation a conduit Hubble à formuler sa célèbre loi, selon laquelle la vitesse d’éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance. Cette vitesse d’éloignement est également appelée récession. Cela a été un argument majeur en faveur de l’idée d’un univers en expansion.
Réévaluation du modèle cosmologique
L’expansion de l’univers, observée par Hubble, a conduit à une réévaluation du modèle cosmologique, car jusqu’ici, on pensait que l’univers était éternellement statique et existait depuis l’éternité.
À partir des années 1990, les découvertes récentes ont montré que l’expansion de l’univers ne ralentissait pas, mais au contraire, semblait s’accélérer. Aujourd’hui, on pense que cette accélération montre qu’une force répulsive mystérieuse est à l’œuvre. Bien que nous n’ayons jamais pu prouver l’existence de cette force répulsive et que nous n’ayons aucune idée de son fonctionnement, cette force a été appelée l’énergie noire. Celle-ci exercerait une force répulsive, contrecarrant l’attraction gravitationnelle des galaxies.
Lemaître et l’univers en expansion
La découverte de Hubble a permis de confirmer les idées du mathématicien Lemaître, qui, en 1927, avait proposé que l’univers était en expansion. Lemaître avait émis l’hypothèse que les galaxies s’éloignaient les unes des autres, suggérant ainsi que l’univers n’était pas statique, comme le pensaient de nombreux scientifiques à l’époque. Cette idée, qu’il appela “l’hypothèse de l’atome primordial”, annonçait l’idée du Big Bang, qui plus tard serait confirmée par le redshift des galaxies découvertes par Hubble.
C’est pourquoi la découverte de Hubble est aussi attribuée à Georges Lemaître, et que les équations qui en découlent sont appelées aujourd’hui la loi de Hubble-Lemaître.
La singularité et le Big Bang
Si l’on connaît la vitesse de récession des galaxies, on peut facilement en déduire que si ces galaxies s’éloignent avec le temps, elles auraient dû être plus rapprochées entre elles à une époque antérieure. La loi de Hubble-Lemaître permet ainsi de déterminer l’instant où, à l’origine, toute la matière de l’univers était contenue dans un volume minuscule, appelé singularité.
La relativité générale et la dilatation du temps
Selon la relativité générale, cette singularité aurait dû provoquer une gravité infinie, entraînant une dilatation du temps et un ralentissement infini jusqu’à l’arrêt total de celui-ci. C’est de là qu’est venue l’idée courante, mais débattue, que le temps ne pouvait plus exister au moment de la singularité, et que donc le temps ne commence qu’après le Big Bang, à la sortie de cette singularité. Cette idée ne fait pas l’unanimité parmi les scientifiques ; pour plus de détails, voir l’article connexe.
Avez-vous trouvé une erreur ? Merci d’en discuter dans les commentaires.
Article suivant