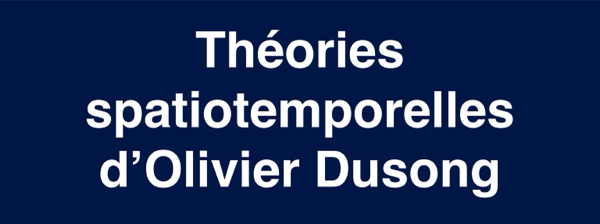Ma théorie du Tempovect & ce que la relativité n’explique pas
©️Olivier Dusong 1998-2024
Introduction
L’expérience de pensée des jumeaux d’Einstein illustre une pensée fascinante : le jumeau voyageant à une vitesse proche de la lumière revient plus jeune que celui resté sur Terre. Ce phénomène, confirmé par des horloges atomiques, découle de la dilatation temporelle prédite par la relativité restreinte.
Cela montre que le temps s’écoule différemment selon le référentiel de mouvement, bouleversant l’idée d’une temporalité universelle. Mais cette théorie, bien qu’elle décrive précisément le ralentissement du temps, ne répond pas à une question essentielle : pourquoi la vitesse modifie-t-elle le cours du temps ?
La drôle découverte de l’explication personnel qui allait devenir le Tempovect
Depuis ma jeunesse, l’expérience des jumeaux d’Einstein illustrait pour moi le principe de la relativité. L’idée qu’un jumeau voyageur vieillisse moins vite en approchant de la vitesse de la lumière me suggérait que le temps possédait une vitesse propre.
En relativité restreinte, les photons voient le temps s’arrêter car ils atteignent la vitesse du temps lui-même. À l’image d’un avion dans lequel une assiette semble immobile pour un passager en train de manger, un photon, se déplaçant à la vitesse du temps, voit le flux temporel figé. Il échappe ainsi au passé, au présent et au futur, évoluant dans un cadre intemporel où il est simultanément émis et absorbé.
Cette analogie permet de comprendre pourquoi un voyageur vieillissant moins vite en s’approchant de cette vitesse limite ne peut la dépasser. Il ne peut aller au-delà de la vitesse à laquelle le temps prend forme. Cela explique intuitivement pourquoi rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. À cette limite extrême, le temps se fige, car le photon avance à la vitesse exacte où le temps s’exécute.
Plus un voyageur s’approche de cette vitesse, plus son flux temporel ralentit. S’il pouvait atteindre ce point, comme le photon, le vieillissement deviendrait impossible. Ce point, où le temps s’arrête, marque ainsi l’émergence du temps lui-même, reliant la vitesse de la lumière à celle du temps.
Comment ai-je découvert que cette explication était purement personnelle ?
Cela fait des années que je pensais comprendre la relativité restreinte à travers l’idée que le temps avait une vitesse propre, et que plus on s’en approchait, plus le flux du temps ralentissait naturellement. Cette conception me semblait logique pour expliquer pourquoi un voyageur vieillissait moins vite à mesure qu’il se rapprochait de la vitesse de la lumière, désignée par la lettre C par les scientifiques.
Mais quelle n’a pas été ma surprise, en échangeant avec l’IA, de réaliser que cette vision n’était pas exactement celle de la relativité restreinte, mais plutôt une interprétation personnelle que j’avais intuitivement développée en me documentant à travers des livres de vulgarisation scientifique.
Je me rends compte aujourd’hui que cette interprétation, bien qu’informelle, s’avère extrêmement pratique, car elle permet d’expliquer des aspects que la relativité restreinte ne clarifie pas. En effet, l’IA m’a fait remarquer que si la relativité restreinte prévoit avec précision l’accélération ou le ralentissement des flux temporels en fonction des référentiels, elle se contente de prédire ces phénomènes sans expliquer pourquoi le temps ralentit précisément à l’approche de la vitesse C, ni pourquoi cette vitesse constitue une limite infranchissable.
En revanche, mon interprétation propose une explication intuitive à ces questions. Elle considère que le temps a une vitesse d’exécution propre, et que cette vitesse, correspondant à C, représente le seuil maximal au-delà duquel le temps ne peut plus s’écouler. Pour moi, ce mécanisme éclaire naturellement pourquoi le temps ralentit lorsqu’on se rapproche de C, et pourquoi aucun objet ne peut dépasser cette vitesse : il ne pourrait aller plus vite que le processus même d’émergence du temps.
Cette prise de conscience m’a amené à considérer que cette interprétation personnelle pourrait constituer une nouvelle manière d’interpréter les données de la relativité restreinte. En discutant avec l’IA, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’une telle théorie, bien qu’elle exige de clarifier certains nouveaux concepts, pourrait s’accorder avec la théorie standard tout en offrant des réponses à des questions que cette dernière laisse en suspens.
Donner un nom au Tempovect
Pour nommer cette interprétation, j’ai choisi le terme Tempovect, une contraction de “temps” et “vecteur”. Ce concept désigne la vitesse à laquelle le temps est engendré, représentée par le vecteur temporel, offrant ainsi une explication à son ralentissement à l’approche de cette vitesse limite.
Différence entre la relativité restreinte et le Tempovect
L’IA m’a fait remarquer un paradoxe évident : parler de “vitesse du temps” dans le cadre de la relativité pose un paradoxe, car le temps y est relatif. Une heure à bord d’un vaisseau spatial n’est pas équivalente à une heure sur Terre, chaque référentiel définissant son propre écoulement temporel. Cette relativité rend contradictoire l’idée de mesurer une “vitesse du temps”, puisque le temps fluctue selon les référentiels.
La relativité se limite donc à constater les variations du flux temporel, sans mesurer une vitesse du temps à proprement parler, car cela nécessiterait de se référer à un temps absolu qui n’existe pas dans ce cadre. Cet argument m’a paru solide et m’a fait beaucoup réfléchir.
À la suite de cette remarque, une longue discussion a eu lieu, permettant d’approfondir la distinction entre le flux temporel et le Tempovect. Nous avons conclu que le paradoxe se dissipe si l’on comprend que le Tempovect et le flux temporel sont deux notions différentes.
Le flux temporel correspond à l’écoulement relatif du temps dans chaque référentiel, qui peut ralentir ou accélérer selon la vitesse et la gravité. Le Tempovect, en revanche, est une propriété fondamentale et universelle du temps, indépendante de ces fluctuations. Il représente la vitesse à laquelle le temps est généré dans l’univers, sans dépendre des référentiels.
Nous avons alors conclu que clarifier cette distinction permet d’éviter la contradiction : il devient possible de parler d’une vitesse du temps dans le sens du Tempovect, même si le flux temporel varie entre les référentiels. Cette réflexion a permis d’affiner et de consolider la théorie du Tempovect.
Différencier le flux temporel et le Tempovect
Nous avons alors conclu qu’il était absolument essentiel, pour dissoudre la contradiction évoquée, de distinguer deux notions : le flux temporel, qui varie selon les référentiels, et le Tempovect, qui représente la vitesse à laquelle le temps se génère.
En effet, la notion du Tempovect repose sur deux observations simples déjà confirmées par la relativité :
1. Le temps ralentit à mesure qu’on approche de la vitesse de C.
2. Pour un photon voyageant à la vitesse de C, le temps cesse totalement d’exister. En conséquence, toute distinction entre passé, présent et futur disparaît également, ce qui est aussi prédit par la relativité.
Ces éléments me permettent de localiser précisément le point où le flux du temps s’arrête et, inversement, d’identifier l’endroit d’où il émerge par le Tempovect, car il constitue le vecteur d’émergence du temps.
En amont du Tempovect, le temps n’existe pas encore, puisqu’il n’est pas encore généré. En revanche, en aval, le flux temporel commence. Le Tempovect marque alors la ligne de démarcation entre le monde intemporel en amont et le monde temporel en aval du Tempovect.
Étant donné que le Tempovect est cette frontière entre le monde temporel et intemporel, il nous a semblé logique qu’au niveau précis où le temps est généré, le temps lui-même n’existe pas encore. Il ne peut exister qu’une fois créé, lorsque son écoulement permet l’apparition d’un flux temporel. Ainsi, le Tempovect est un lieu intemporel, et le temps ne commence réellement son existence qu’une fois déployé et sorti du Tempovect.
Cette idée nous a amenés à distinguer le Tempovect, qui est un point de génération intemporel, du flux temporel, qui n’apparaît qu’après ce déploiement, et de bien comprendre la différence entre ces deux éléments pour ne pas les confondre.
Tant que ce déploiement n’a pas eu lieu, il est impossible de parler de durée ou d’écoulement temporel. C’est uniquement après avoir quitté le Tempovect que le temps émerge, à partir de la sortie du Tempovect, permettant aux événements de s’inscrire dans une chronologie.
Cela explique pourquoi, dans le référentiel du photon, le temps n’a aucun sens. Le photon se situe toujours précisément à la frontière du Tempovect, à l’endroit où le temps émerge après sa construction. À cet endroit, le temps ne s’est pas encore déployé en une durée puisqu’il correspond au point précis où le temps sort du Tempovect sans avoir encore le temps de s’écouler.
Par conséquent, pour le photon, il n’y a ni passé, ni présent, ni futur, car il surfe sur la vague du Tempovect dans un état qui rappelle les notions de “l’univers bloc” ou d’omnilocation dans la 6D déjà abordées dans ce livre.
Puisque le temps ne peut exister sans se déployer, il est logique qu’au niveau du photon, toute notion de temps s’effondre : le photon reste toujours collé au Tempovect, là où le temps n’a pas encore commencé.
Mais une autre question émerge alors : comment le Tempovect pourrait constituer la vitesse du temps si celui-ci est lui-même intemporel ? Tout simplement parce que le Tempovect est le point à partir duquel, derrière lui, le temps émerge directement une fois créé. Le Tempovect lui-même est hors du temps, mais il produit un temps qui, lorsqu’il émerge de lui, avance à la vitesse avec laquelle le Tempovect le produit. Cela résout ce paradoxe : le Tempovect est effectivement la vitesse du temps, puisque la vitesse du flux temporel universel émerge précisément à la vitesse auquel le Tempovect le produit.
Le référentiel du photon existe dans le Tempovect, contrairement à la relativité restreinte.
Tandis que la relativité stipule que le référentiel du photon est inexistant, puisque pour lui il n’y a pas de temporalité mesurable, le Tempovect le considère comme un point où le temps n’a pas encore commencé à se déployer. Bien que ce référentiel ne soit pas mesurable, il définit l’endroit où le temps émerge. Ainsi, le photon représente une position intemporelle où le temps cesse d’exister, mais aussi d’où il émerge.
C’est ici une nouveauté par rapport à la théorie standard. En relativité restreinte, le référentiel du photon n’existe pas, car pour lui, le temps est inexistant, et on ne peut pas parler de référentiel sans écoulement de temps. Cependant, dans le cadre du Tempovect, ce référentiel existe parce que je le considère comme le point où le temps commence à émerger. Le photon, en étant à la limite de cette émergence, représente le moment où le temps, encore indéfini, commence à se déployer. Ainsi, pour moi, le référentiel du photon n’est pas une absence de temps, mais un point charnière dans le processus d’apparition du temps.
Ce changement de paradigme explique pourquoi je parle du référentiel du photon dans le cadre du Tempovect. Alors que la relativité restreinte le considère inexistant, le Tempovect le voit comme le point où le temps émerge. Le photon, à la limite de cette émergence, représente le moment où le temps commence à se déployer.
Cette formulation est essentielle pour préciser que le référentiel du photon ne correspond pas à un référentiel où le temps s’écoule comme dans les autres. Il s’agit du point d’où le temps commence son émergence. Ce référentiel est donc fondamental, car il explique pourquoi les autres référentiels fluctuent par rapport à celui du photon.
Le Tempovect, une notion pas si étrangère que cela
Bien que la notion de vitesse du temps, ou Tempovect, ne soit pas explicitement formulée dans la relativité restreinte, elle semble découler de ses principes fondamentaux. On sait déjà que le temps ralentit à mesure qu’on se rapproche de la vitesse C et qu’il s’arrête à cette vitesse. Puisque C est une limite infranchissable, j’en déduis que cette limite provient des propriétés mêmes du temps : la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée car elle est intrinsèquement liée à la vitesse maximale du temps, que j’appelle Tempovect.
Autrement dit, si la lumière ne peut parcourir plus d’espace qu’à 300 000 km/s, c’est parce que le Tempovect impose cette limite. Toutefois, il ne faut pas confondre la vitesse C — qui est une mesure de l’espace parcouru en un temps donné — avec le Tempovect, qui est une vitesse purement temporelle, indépendante de la lumière.
Preuve du Tempovect à travers la relativité
L’existence du Tempovect est, selon moi, démontrée par la relativité. À mesure qu’on approche de la vitesse C, le flux du temps ralentit jusqu’à s’arrêter, prouvant qu’une vitesse maximale pour le temps existe, indépendante des fluctuations temporelles entre référentiels.
Le Tempovect ne remplace pas le flux temporel, mais le complète comme une notion nouvelle. La relativité, en montrant que le temps s’arrête pour un photon, confirme implicitement que rien ne peut aller plus vite que le temps, validant ainsi l’existence du Tempovect.
Ce concept apporte des explications supplémentaires déjà étayées empiriquement par le ralentissement du temps à l’approche de C, ce qui suffit à en démontrer la réalité. Même l’IA a fini par reconnaître la force de cette argumentation.
Ne pas confondre la vitesse du temps avec la vitesse de la lumière de C
J’ai longtemps pensé que le Tempovect pouvait correspondre à la vitesse de C, mais cette idée est incorrecte. La vitesse de la lumière est une vitesse spatiotemporelle qui associe une distance et un temps, par exemple 300 000 km/s. Le Tempovect, quant à lui, est purement temporel et n’implique aucune distance parcourue. Il ne mesure pas un mouvement dans l’espace, mais la vitesse d’exécution du temps lui-même.
Cette distinction est fondamentale. La lumière dépend du temps pour exister, mais le temps n’a pas besoin de la lumière pour s’écouler. Le Tempovect impose une limite temporelle universelle, qui s’exprime par l’arrêt du temps lorsque la vitesse de C est atteinte. Ainsi, le Tempovect ne représente pas la vitesse de C, mais la contrainte fondamentale qui la rend infranchissable.
En réalité, ce n’est pas la vitesse de C qui limite le temps, mais le Tempovect qui impose cette limite à C. Il agit comme un cadre universel, générant le temps à un débit maximal, au-delà duquel aucune vitesse spatiotemporelle n’est possible. Lorsque le temps s’arrête pour un photon à la vitesse C, c’est parce que le photon a atteint la vitesse maximale du temps, définie par le Tempovect.
Cette distinction clarifie le rôle du Tempovect et de la vitesse de C : le premier est une propriété fondamentale du temps, tandis que la seconde est une vitesse spatiale qui respecte cette limite temporelle. En atteignant C, la lumière entre dans un régime où le temps cesse de s’écouler, non pas en raison d’une contrainte intrinsèque de la vitesse de C, mais parce que le Tempovect fixe la limite ultime au déplacement à travers l’espace-temps.
Ne pas confondre le Tempovect avec le flux du temps
Pour clarifier la distinction entre la vitesse du temps, que j’appelle le Tempovect, et le flux du temps, j’ai imaginé une métaphore.Le temps est comme un fleuve dans lequel coule le Tempovect. Imaginons une course spatiotemporelle entre deux jumeaux et un photon, chacun interagissant différemment avec ce fleuve.
Le départ de la course commence depuis une ligne symbolisée par un pont. L’un des jumeaux se laisse porter par une bouée vers l’océan.
Il est emporté sans effort par le courant, suivant la vitesse naturelle du fleuve du temps. Il vieillit à la vitesse à laquelle le Tempovect l’emporte vers l’avenir. En revanche, son autre frère, sur un bateau, utilise toute la puissance d’un moteur pour lutter contre le puissant courant du Tempovect, ralentissant ainsi son avancée vers l’aval du fleuve, c’est-à-dire vers le futur.
Puisqu’il lutte de toutes ses forces contre le Tempovect, il vieillit moins vite, car il est moins rapidement emporté vers le futur. Cependant, puisqu’il ne peut pas aller exactement à la vitesse du Tempovect, c’est-à-dire qu’il voyage en dessous de la vitesse de la lumière, il sera lui aussi lentement emporté vers le futur en aval du fleuve. Pour lui, bien qu’il vieillisse beaucoup moins vite que son frère, il se voit tout de même vieillir dans son propre référentiel. Sa montre ne semble pas ralentir, et il continue de vieillir, mais en raison de sa lutte contre le Tempovect, le flux temporel qu’il vivra dans son organisme le fera vieillir beaucoup moins vite que le flux temporel de son frère, emporté par la bouée. Il ne faut donc pas confondre le flux personnel, qui est relatif et individuel et dépend du mouvement de chaque concurrent dans cette course dans le Tempovect, avec la vitesse universelle du temps, définie par la limite que la lumière ne peut dépasser.
Enfin, le troisième concurrent de cette course spatiotemporelle, le photon, nage à la vitesse exacte du courant. Cela fait que dans son référentiel le temps n’existe plus du tout, puisqu’il va à la vitesse du Tempovect.
Dans son référentiel, il se voit à la fois émis et absorbé au même instant, peu importe la distance parcourue, ce que prédit la théorie de la relativité d’Einstein. Cet état semble étrangement similaire à l’état hypothétique de l’omnilocation en 6D où passé, présent et futur se confondent, ou encore à l’intrication quantique.
Mais revenons à la métaphore, elle permet aussi de mieux comprendre pourquoi il est impossible pour le photon de voyager plus d’espace que le temps lui permet de parcourir. Dépasser les 300 000 km/s signifierait parcourir plus d’espace que l’écoulement du Tempovect ne lui permettrait de parcourir.
Ainsi, il ne peut pas remonter le Tempovect, et passer le pont pour rejoindre l’amont du fleuve, car en amont du fleuve, le temps n’a pas encore commencé à exister. Traverser le temps plus vite que le temps signifierait remonter dans le passé.
Dans cette métaphore, le fleuve du Tempovect est particulier, car le pont symbolise non seulement le départ de la course, mais aussi le début du temps.
En amont du pont, le fleuve n’existe pas réellement, car dans cette représentation, le temps n’a pas encore commencé. Remonter le fleuve en amont du pont signifierait aller plus vite que le temps et donc remonter dans le passé.
Cette métaphore permet ainsi de dissocier le flux du temps relatif du Tempovect. La vitesse du temps, c’est le Tempovect, et le flux du temps est l’impact qu’il a sur notre flux personnel temporel, ce qui est une autre chose.
Quelle est la nouveauté du Tempovect ?
Ce qui est nouveau dans ma proposition, c’est l’idée que l’annulation du temps pour un photon démontre la “vitesse du temps”. Plutôt que de simplement constater que le temps se fige à la vitesse de la lumière, sans explication, je propose d’interpréter ce phénomène comme la manifestation d’une limite à la vitesse du temps lui-même. Pour un photon, le temps ne s’écoule pas, ce qui montre que le temps a une “vitesse” propre : le Tempovect.
Cette interprétation est une vraie nouveauté, non pas parce qu’il n’y a pas de preuves que le temps ralentit et s’arrête à la vitesse C – cela est déjà découvert et empiriquement vérifié – mais parce que j’interprète ce ralentissement progressif comme le rattrapage de la vitesse du temps lui-même.
Je pense que cette idée est aussi simple que logique. Ce n’est pas une découverte en soi, puisque l’on sait déjà qu’à cette vitesse le temps s’arrête. Ce qu’il y a de nouveau ici, c’est d’interpréter cet arrêt comme le fait que la vitesse du temps ne peut plus suivre. Cette interprétation me paraît utile, en accord avec la relativité, et élégante pour mieux expliquer le phénomène de la limitation de la vitesse de la lumière et pourquoi le temps ralentit lorsque l’on s’approche de C. Cela dépasse l’idée abstraite de dilatation temporelle, souvent contre-intuitive, que même des scientifiques peinent parfois à comprendre tant elle s’éloigne de notre logique.
Avec le Tempovect, tout devient plus simple et logique : on comprend pourquoi rien ne peut dépasser C et pourquoi le flux du temps change en fonction de la vitesse dans l’espace. Cette réintégration dans la relativité restreinte introduit l’idée que la vitesse du temps – puisqu’elle s’arrête à C – est une constante universelle qu’il faut nommer : le Tempovect.
Le Tempovect, ou vitesse universelle du temps, ne doit pas être confondu avec le flux du temps, qui, lui, est fluctuant. Sans cette notion, la relativité restreinte sait parfaitement prévoir et calculer le ralentissement du temps, mais ne peut expliquer que ce ralentissement est précisément dû au rattrapage du Tempovect.
Ainsi, le Tempovect pourrait devenir non seulement un outil pédagogique pour expliquer la relativité au grand public, mais aussi une clé pour résoudre certaines interrogations fondamentales. Sans le Tempovect, la relativité restreinte restera toujours une théorie très contre-intuitive. Avec lui, elle pourrait être comprise sous un jour totalement nouveau.
Le Tempovect permet aussi de réinterpréter la relativité : plutôt que de voir le temps varier seulement en fonction des référentiels, on peut comprendre ces variations comme des écarts par rapport à une vitesse universelle connue, celle du Tempovect. Cela ne remet pas en question la relativité des flux temporels, mais introduit une mesure absolue, un cadre temporel universel qui impose des limites aussi bien au temps qu’à C.
Avec le Tempovect, la relativité est vue non seulement comme une question de mesure relative, mais comme une conséquence directe d’un cadre temporel universel, une constante globale : le Tempovect, qui impose des limites à l’écoulement du temps et à C.
En d’autres termes, avec le Tempovect, la relativité devrait être comprise non seulement comme une question de mesure relative entre les référentiels, mais comme une conséquence directe des limites imposées par le Tempovect. Plus nous avançons vite, plus nous nous rapprochons de la vitesse universelle du Tempovect, et plus le flux du temps se dilate et ralentit. Cela permet d’expliquer que le flux du temps dépend directement de la proximité ou de l’éloignement par rapport à cette vitesse universelle.
Ainsi, il devient évident que le ralentissement du temps est une conséquence naturelle du rapprochement avec le Tempovect, ce qui explique également pourquoi le temps se réduit proportionnellement à l’espace parcouru. Ce n’est donc pas que C impose une vitesse limite, mais bien que le Tempovect détermine cette limite, dictant à C la frontière qu’elle ne peut dépasser.
Mesurer le temps depuis sa limite, pas entre les référentiels
Bien que la notion de Tempovect que je propose ne soit pas explicitement formulée dans la relativité restreinte, elle semble découler des concepts fondamentaux de la théorie. En effet, plus un objet approche de la vitesse de la lumière, plus son flux temporel ralentit, jusqu’à disparaître lorsque cette vitesse est atteinte.
De notre perspective, le flux du temps diminue progressivement à mesure que l’on s’approche de la vitesse limite imposée par la lumière. À partir de ce constat, deux interprétations peuvent émerger.
La première interprétation est que, puisque le flux temporel varie selon les référentiels, cela signifie que le temps est relatif.
La seconde interprétation suggère que, si le temps s’arrête à la vitesse de la lumière, cela reflète une limite absolue où le mouvement atteint la vitesse maximale permise par le temps pour parcourir l’espace. Cela conduit à envisager que le temps pourrait posséder une vitesse intrinsèque, ou générale.
Ces deux déductions, loin de s’opposer, interfèrent et se renforcent mutuellement dans le cadre du Tempovect.
Le Tempovect propose une approche différente de la relativité restreinte. Au lieu de mesurer le temps en fonction des référentiels relatifs entre deux événements, où le temps fluctue constamment, il s’agit de mesurer le temps par rapport au Tempovect lui-même, c’est-à-dire le point où le flux temporel cesse. On sait alors que la vitesse maximale du temps correspond à celle du photon. Au-delà de cette frontière, le temps cesse littéralement d’exister.
En d’autres termes, le Tempovect propose de mesurer les événements en fonction de leur distance au Tempovect, et non entre leurs référentiels respectifs. C’est l’écart entre la vitesse propre de chaque objet et la vitesse limite où le flux temporel cesse, définie par le Tempovect, qui permet de comprendre la structure du flux temporel. Cela révèle que la véritable vitesse à laquelle le temps est généré, à la sortie du Tempovect, correspond spatialement à la vitesse de la lumière.
Cette distinction entre le flux temporel, mesuré habituellement depuis les référentiels, et le Tempovect, qui représente une vitesse absolue de génération du temps, constitue la véritable nouveauté du Tempovect.
Note : Cette théorie est en développement et propose de donner des explications à d’autres énigmes, notamment, je pense qu’elle pourrait résoudre le paradoxe du “Parcours Éternel des Moitiés Restantes” (PÉMR). Pour plus d’informations, veuillez consulter la page connexe.