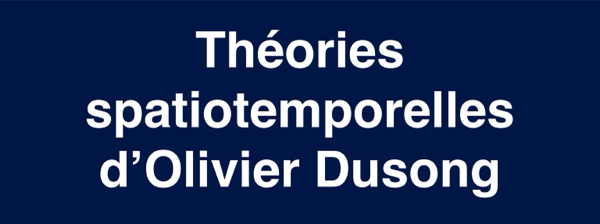La discorde du Principe d’indétermination d’Heisenberg

Formulé en 1927, le Principe d’indétermination stipule que certaines paires de grandeurs physiques, telles que la position et la quantité de mouvement (vitesse multipliée par la masse) d’une particule, ne peuvent pas être mesurées simultanément avec une précision arbitraire. Plus précisément, plus on détermine avec précision l’une de ces grandeurs, moins il est possible de connaître précisément l’autre.
Si aujourd’hui on entend fréquemment que le Principe d’indétermination d’Heisenberg découle de la nature quantique de la matière et de l’énergie, j’ai récemment pris conscience que cette interprétation n’est pas neutre. Elle repose en réalité sur l’interprétation de Copenhague, qui n’est pas la seule option possible. C’est pourquoi j’ai décidé de partager cette nouvelle compréhension, moins connue, à travers cet article.
En effet, lorsque l’on affirme que le Principe d’indétermination est une caractéristique fondamentale de la physique quantique, il ne s’agit pas d’une position objective. Cette vision a été largement imposée par l’école de Copenhague. Toutefois, une autre manière d’interpréter cette réalité, beaucoup moins obscure, existe : celle de la théorie de De Broglie-Bohm. Il me semble donc essentiel d’exposer en détail ces deux interprétations afin d’élargir notre perspective sur l’interprétation de l’onde pilote, moins connue mais tout aussi pertinente.
Une réticence scientifique
Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie et David Bohm étaient tous fermement convaincus que les particules possédaient des positions et des vitesses bien définies à tout moment. Ils n’auraient jamais accepté qu’en 2025 l’idée que le Principe d’indétermination d’Heisenberg soit considéré comme une véritable caractéristique physique de la nature. Au contraire, pour eux, il était évident que les électrons suivaient des trajectoires déterminées. Cette conviction profonde les a conduits à critiquer l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, qui soutient que les particules n’acquièrent des propriétés définies qu’au moment de la mesure. Einstein, par exemple, exprimait son scepticisme en déclarant : « Je ne peux pas croire que Dieu joue aux dés avec l’univers », mettant ainsi en évidence son désaccord avec l’idée d’indéterminisme inhérente à l’interprétation de Copenhague. Schrödinger, quant à lui, proposa l’expérience de pensée du « chat de Schrödinger » pour illustrer les paradoxes et les limites de cette interprétation. Bien qu’ils n’aient pas explicitement soutenu l’interprétation de l’onde pilote, leur conviction que les particules suivent des trajectoires définies reflétait une vision déterministe de la réalité quantique.
L’interprétation de Copenhague
Dans l’interprétation de Copenhague, qui est l’une des plus répandues, le Principe d’indétermination d’Heisenberg reflète une propriété fondamentale de la réalité quantique : l’incertitude n’est pas due à une imperfection de nos instruments de mesure, mais à la nature même des particules. Selon cette approche, une particule n’a pas une position et une vitesse définies tant qu’elle n’est pas mesurée. Avant l’observation, elle existe dans un état de superposition, où toutes les valeurs possibles pour ces grandeurs sont présentes simultanément, représentées par la fonction d’onde.
Contrairement à une simple inconnue, comme lorsqu’on ne connaît pas la vitesse d’un mobile parce qu’on ne l’a pas mesurée, l’indétermination en mécanique quantique signifie que la particule elle-même n’a pas de valeur précise avant l’observation. Elle ne se trouve pas dans un état défini à la fois onde et particule, mais dans une description purement ondulatoire, régie par la fonction d’onde. Ce n’est que lorsqu’on effectue une mesure que cette fonction d’onde « s’effondre », attribuant alors à la particule une position ou une vitesse déterminée.
En d’autres termes, l’indétermination ne résulte pas seulement de l’incapacité de connaître ces grandeurs avec précision avant la mesure : c’est l’acte même d’observation qui interfère avec la fonction d’onde et provoque son effondrement, donnant naissance à une réalité corpusculaire à cet instant précis. Avant cette interaction, la particule n’existe que sous forme de probabilité, sans trajectoire définie ni position spécifique.
L’indétermination est donc bien plus qu’une simple ignorance : c’est une propriété intrinsèque du monde quantique. Les particules ne suivent pas de trajectoires bien définies comme en mécanique classique, elles existent dans un nuage de probabilités jusqu’à ce qu’une observation vienne fixer une valeur mesurable.
Le nuage électronique
Un exemple souvent utilisé pour illustrer cette idée est celui du nuage quantique de l’électron autour du noyau d’un atome aussi appelé nuage électronique ou nuage quantique. En mécanique classique, on s’attendrait à ce qu’un électron suive une orbite bien définie autour du noyau, comme une planète autour du Soleil. Or, selon l’interprétation de Copenhague et le Principe d’indétermination d’Heisenberg, il est impossible de connaître simultanément la position et la vitesse d’un électron avec une précision arbitraire.
Ainsi, plutôt que de parler d’une trajectoire, la mécanique quantique décrit l’électron sous la forme d’un nuage de probabilité. Ce nuage, appelé orbitale électronique, représente les différentes positions où l’électron a une certaine probabilité d’être détecté lors d’une mesure. Avant la mesure, l’électron ne se trouve pas en un point précis mais dans une superposition de toutes ces positions possibles, formant une distribution probabiliste.
Lorsqu’un instrument vient interagir avec l’électron pour mesurer sa position, la fonction d’onde s’effondre instantanément, et l’électron est détecté en un point unique. Avant cette mesure, cependant, il n’existe pas en tant que particule localisée, mais plutôt comme une onde de probabilité répartie dans l’espace.
Ce modèle du nuage quantique illustre bien que l’indétermination ne signifie pas simplement qu’il nous manque des informations, mais que la notion même de position et de vitesse précises n’a pas de sens tant qu’une mesure n’a pas été effectuée. L’électron n’a pas une trajectoire prédéterminée qu’on pourrait révéler avec des instruments plus perfectionnés ; il est réellement dans un état de superposition jusqu’à l’observation.
L’onde pilote et le principe d’indétermination
Au contraire l’interprétation de l’onde pilote, développée par Louis de Broglie en 1927 puis approfondie par David Bohm dans les années 1950, propose une vision déterministe du Principe d’indétermination d’Heisenberg. Contrairement à l’interprétation de Copenhague, qui considère que la position et la vitesse d’une particule ne sont pas définies tant qu’elles ne sont pas mesurées, l’onde pilote affirme que ces grandeurs de quantité d’espace parcouru et de vitesse ainsi que de trajectoire existent à tout instant, même si elles ne sont pas directement accessibles à l’observation.
Dans cette approche, une particule quantique est toujours accompagnée de sa nature d’onde qui la guide dans sa trajectoire. Cette onde pilote, qui n’est rien d’autre que la fonction d’onde de Schrödinger, détermine la trajectoire de la particule, qui possède une position et une vitesse bien définies à chaque instant. L’incertitude du Principe d’indétermination ne traduit donc pas une absence de trajectoire, mais plutôt une limite inhérente à nos instruments de mesure, qui ne peuvent pas sonder simultanément la position et la vitesse d’une particule sans interagir avec elle et perturber son mouvement.
Ainsi, les variables cachées postulées par cette théorie ne sont pas fondamentalement inaccessibles, mais sont précisément les limites de nos instruments, elles restent hors de notre portée en raison de la manière dont ces instruments interagissent avec les systèmes quantiques. Dans cette autre interprétation du Principe d’indétermination d’Heisenberg
nos mesures influencent inévitablement l’état des particules, ce qui empêche d’obtenir simultanément des informations précises sur toutes leurs propriétés.
Dans l’interprétation de l’onde pilote, la fonction d’onde n’est pas simplement une onde de probabilité, comme dans l’interprétation de Copenhague, mais elle représente une onde réelle qui guide la particule. Cette onde pilote détermine la trajectoire de la particule, qui possède une position et une vitesse bien définies à tout instant. Ainsi, la fonction d’onde décrit la nature quantique ondulatoire de la particule, et non une probabilité de sa localisation ou de son état.
Dans cette interprétation, il n’y a pas d’effondrement de la fonction d’onde ni de mystérieux pouvoir de l’observation qui modifie l’état d’un système quantique. L’interprétation de l’onde pilote est beaucoup plus terre-à-terre et simple.
La fonction d’onde reste une entité continue et déterministe, et l’apparente indétermination provient de notre incapacité à mesurer simultanément la position et la vitesse de la particule sans perturber son mouvement. Ainsi, l’indétermination n’est pas une propriété fondamentale de la nature, mais une conséquence de notre interaction avec le système quantique.
Mais ce n’est pas le seul avantage de cette théorie trop souvent oubliée, car elle permet d’expliquer des phénomènes tels que l’expérience des fentes de Young en supposant que chaque particule suit une trajectoire bien définie sous l’influence de l’onde pilote, tout en produisant des motifs d’interférence caractéristiques de la mécanique quantique. Dans ce cadre, l’effondrement de la fonction d’onde n’est pas un phénomène fondamental mais une conséquence de l’interaction entre l’onde, la particule et l’instrument de mesure. Contrairement à l’interprétation de Copenhague, où l’indétermination est une propriété intrinsèque de la nature, l’onde pilote propose une vision où l’incertitude est une conséquence de notre incapacité à mesurer sans perturber le système.
Conclusion : Rouvrir les tiroirs
L’effet tiroir est une métaphore qui désigne le fait de reléguer une idée ou une théorie dans un coin, l’oubliant ou la négligeant, sans même la considérer comme une option sérieuse. C’est comme si une idée, bien qu’intéressante et potentiellement valable, était mise de côté, perdue parmi d’autres concepts plus dominants, sans que l’on lui accorde l’attention qu’elle mérite.
Dans le domaine de la physique quantique, nous devons reconnaître que nos théories proviennent en grande partie de l’héritage de querelles intellectuelles entre une petite poignée de physiciens, dont les débats et divergences ont façonné l’évolution de la discipline. L’école de Copenhague, avec ses idées formulées principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg, a eu une influence déterminante, et son interprétation de la mécanique quantique est celle qui s’est imposée. Cependant, cela ne signifie pas que les autres visions, telles que celle de l’onde pilote de de Broglie et Bohm, soient moins légitimes. En réalité, ces idées ont aussi proposé des explications fascinantes et cohérentes des phénomènes quantiques, sans les paradoxes de l’interprétation de Copenhague.
Aujourd’hui, dans un esprit véritablement scientifique, je me demande si il n’est pas temps de réhabiliter l’onde pilote comme une alternative sérieuse. Elle mérite une réévaluation plus approfondie et objective, en prenant en compte que notre compréhension actuelle de la mécanique quantique, influencée par les querelles du passé, n’est pas neutre. Redécouvrir ces théories oubliées pourrait non seulement enrichir notre vision de la réalité quantique, mais aussi nous rappeler que la science, dans sa quête de vérité, doit rester ouverte à la diversité des idées, même celles qui ont été mises de côté.