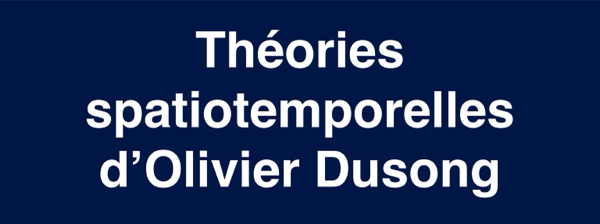Einstein avait tort : L’expérience à double fente d’Einstein-Bohr
Une vieille expérience de pensée d’Einstein réalisée en 2015 lui donne tort : cette expérience a été réalisée au Centre de physique du CNRS du Synchrotron SOLEIL près de Paris.
En 1927, lors de la célèbre conférence Solvay, Albert Einstein et Niels Bohr engagèrent un débat philosophique et scientifique sur la mécanique quantique, en particulier sur la célèbre expérience des fentes, élaborée par Thomas Young en 1801.
Depuis des années, les deux amis débattaient de l’interprétation qu’il fallait tirer de cette expérience.
Pour Bohr, le simple fait de connaître par quelle fente passait la particule suffisait à provoquer la disparition des franges d’interférence à cause du principe d’indétermination d’Heisenberg, qui établit qu’il est impossible de connaître simultanément et avec précision la position et la quantité de mouvement d’une particule. Ainsi, la connaissance de la position de la particule entraîne l’effondrement de la fonction d’onde. Tant que la trajectoire de la particule reste indéterminée, elle suit une onde de probabilité, où sa position avant la mesure est indéterminée. Autrement dit, la particule est dans une superposition d’états, à la fois onde et particule, et dans cet état, elle obéit au principe d’indétermination d’Heisenberg. Mais dès que l’on obtient l’information sur son passage par une fente spécifique, la particule adopte un comportement corpusculaire, ce qui fait disparaître les interférences.
Ainsi, selon Bohr, toute tentative de mesure altérait inévitablement le système quantique, entraînant la perte du comportement ondulatoire.
Einstein, quant à lui, rejetait cette interprétation. Il soutenait que la disparition des interférences n’était pas une conséquence inévitable de la mesure elle-même, mais plutôt le résultat d’une perturbation physique réelle causée par l’interaction entre la particule et l’appareil de mesure. Selon lui, la disparition des interférences ne pouvait s’expliquer que par une influence mécanique mesurable et non seulement par le fait de savoir ou non par quelle fente la particule passait.
L’expérience des fentes de Young amélioré par l’imagination d’Einstein
Un appareil de mesure fonctionne en interagissant avec le système qu’il cherche à observer. Qu’il s’agisse d’un détecteur de lumière, d’un capteur électronique ou d’un autre dispositif, il doit nécessairement capter un signal issu de la particule pour en extraire une information. Cette interaction implique souvent l’échange d’énergie, comme l’émission ou l’absorption d’un photon, ou encore la diffusion d’une onde électromagnétique. En physique classique, on suppose généralement que cette interaction peut être rendue aussi faible que nécessaire pour ne pas perturber de manière significative l’état du système mesuré.
Einstein, fidèle à une vision réaliste de la physique, pensait que c’était cette interaction qui était la clé du comportement étrange qui fait que, lorsque l’on cherche à mesurer par quelle fente la particule passe, les franges d’interférences disparaissent inévitablement.
C’est pourquoi il imagina un dispositif ingénieux permettant d’identifier la trajectoire des particules sans recourir à une interaction directe avec un appareil de mesure classique, évitant ainsi toute perturbation invasive.
Il savait que lorsqu’une particule traverse une fente, elle exerce une infime poussée sur la plaque en raison du transfert d’impulsion. Son idée reposait donc sur l’exploitation de cette propriété naturelle pour détecter par quelle fente la particule était passée, sans utiliser un détecteur classique susceptible d’altérer son comportement.
Il proposa alors un système extrêmement sensible qui utiliserait cette poussée infime de la particule pour savoir par quelle fente elle passait. Au lieu de placer une plaque munie de deux fentes, il imagina deux plaques indépendantes, l’une fixe et l’autre suspendue à des ressorts. Si un mouvement était détecté sur la plaque suspendue aux ressorts, cela indiquerait que la particule était passée par la fente correspondante. En revanche, si la particule passait par la seconde plaque, non équipée de ressorts, aucun mouvement ne serait détecté sur la première plaque. Ce dispositif aurait permis de savoir instantanément par quelle fente la particule était passée, sans perturber son comportement.
Si cette méthode permettait d’identifier le trajet de la particule sans modifier son comportement ondulatoire, Einstein pensait que les franges d’interférences ne disparaîtraient pas, contrairement à ce qui se produisait dans l’expérience traditionnelle des fentes de Young.
Une telle observation aurait invalidé, selon lui, l’interprétation de Bohr et l’aurait conforté dans son idée que la mécanique quantique était incomplète. En revanche, si les franges d’interférences disparaissaient malgré l’absence d’un dispositif de mesure perturbant, cela prouverait sans doute l’interprétation de Bohr, suggérant que ce serait la simple acquisition de l’information sur la trajectoire de la particule qui provoquerait le passage de son état ondulatoire à un comportement corpusculaire.
L’objection de Bohr
Cependant, Bohr pensait que l’approche d’Einstein échouerait en raison du principe d’incertitude de Heisenberg. Selon lui, si l’on parvenait à déterminer par quelle fente la particule était passée, cela impliquerait une connaissance précise de sa position à ce niveau. Or, dans l’interprétation de Bohr, ce n’est pas simplement une question d’incertitude sur l’impulsion : tant que la position de la particule n’est pas mesurée, elle suit un comportement ondulatoire et peut interférer avec elle-même. Mais dès que cette position est connue, la fonction d’onde s’effondre et la particule adopte un comportement corpusculaire, ce qui entraîne la disparition des franges d’interférence. Ainsi, ce n’est pas l’interaction avec un appareil de mesure qui cause cette disparition, mais le simple fait d’obtenir l’information sur la trajectoire de la particule. Dès lors, si Bohr avait raison, il serait impossible d’observer des franges d’interférences tout en connaissant la position de la particule au niveau de la fente. Si, au contraire, ces franges apparaissaient malgré cette connaissance, cela donnerait raison à Einstein et remettrait en cause l’interprétation de Bohr.
L’expérience du synchrotron Soleil qui donne raison à Bohr
Si à l’époque Bohr et Einstein ne possédaient pas la technologie pour réaliser l’expérience des fentes de Young avec le dispositif d’Einstein, en 2015, une équipe de chercheurs du synchrotron Soleil en France a réussi à reproduire cette expérience en utilisant des technologies avancées.
Leurs découvertes furent sans précédent : les franges d’interférences avaient disparu, ce qui semble donner raison à Bohr et non à Einstein.
La portée de cette découverte est énorme : elle confirme que les franges d’interférence ne disparaissent pas en raison d’une perturbation physique, comme le pensait Einstein, mais bien parce que la connaissance de la position de la particule au niveau de la fente suffit à modifier son comportement. C’est donc cette information qui entraîne la perte du phénomène d’interférence, corroborant ainsi le principe d’incertitude d’Heisenberg.
Contrairement à l’hypothèse d’Einstein, ce n’est donc absolument pas l’interaction de la particule avec l’appareil de mesure qui était responsable d’un changement de comportement de la particule. Bohr avait raison : la simple connaissance de la trajectoire d’une particule entraîne la sortie de l’état du principe d’indétermination d’Heisenberg. En connaissant la position de la particule à travers le dispositif ingénieux d’Einstein, même sans interaction directe avec un appareil de mesure, l’effondrement de la fonction d’onde se produit. Le fait de connaître précisément la position de la particule entraîne irrémédiablement cet effondrement, ce qui explique la disparition des franges d’interférence et confirme ainsi la justesse de l’interprétation de Bohr.
La portée incroyable de cette découverte extraordinaire
Cette expérience astucieuse, imaginée par Einstein pour trancher le débat entre lui et son ami, allait finalement pouvoir être réalisée plus de 80 ans plus tard grâce aux avancées technologiques. Si Einstein était là, il reconnaîtrait que son propre dispositif donne raison à Bohr, malgré ses immenses réticences. « La Lune disparaît-elle si je ne la regarde pas ? » demandait ironiquement Einstein pour critiquer l’interprétation de Copenhague. Pourtant, cette expérience confirme que, dans le monde quantique, l’acte d’observer modifie bel et bien la réalité.
Si je regarde le ciel et que je ne vois pas la Lune, cela ne signifie pas qu’elle a cessé d’exister. Elle est toujours là, à une position précise dans son orbite, que je puisse la voir ou non. Ce manque de visibilité est simplement une question de perception, mais la Lune existe indépendamment de mon observation, de ma connaissance de sa position ou de mon ignorance.
Or, ce que l’expérience de la double fente d’Einstein-Bohr démontre, c’est qu’Einstein se trompait sur ce point.
Bien que sa vision du monde soit plus claire, simple et intuitive, cette expérience prouve que Bohr avait raison. Lorsque le principe d’indétermination d’Heisenberg affirme qu’il est impossible de connaître simultanément la position et la vitesse d’une particule quantique, il ne s’agit pas simplement d’un manque d’information, comme lorsque j’ignore où se trouve la Lune dans le ciel. La réalité quantique est bien plus étrange et contre-intuitive que cela.
L’expérience de la double fente d’Einstein-Bohr semble démontrer que tant qu’une particule n’a pas été mesurée en un point précis – par exemple au niveau des fentes dans l’expérience de Young –, elle n’a ni position ni vitesse définies. Elle existe dans un état de superposition, à la fois onde et corpuscule, à la fois partout et nulle part, jusqu’à ce qu’elle soit détectée. Ce n’est qu’au moment où elle frappe l’écran de détection, et que sa position est précisément connue, que sa fonction d’onde s’effondre et qu’elle adopte un état corpusculaire bien défini.
Tant que sa position n’est pas déterminée, la particule ne suit pas une trajectoire précise comme la Lune dans son orbite. Elle se comporte comme une onde de probabilité, qui traverse simultanément les deux fentes et interfère avec elle-même. Mais dès qu’on cherche à connaître sa position – par exemple en plaçant un détecteur à une fente –, sa fonction d’onde s’effondre et elle adopte un comportement purement corpusculaire. Elle cesse alors de produire des interférences et se manifeste comme une particule ponctuelle, marquant une position unique sur l’écran de détection.
En d’autres termes, l’acte même d’observer ou d’obtenir une information sur la position de la particule modifie son comportement et fige son état. Contrairement à ce que pensait Einstein, la physique quantique semble indiquer que la réalité à l’échelle microscopique ne préexiste pas indépendamment de l’observation, mais qu’elle se définit au moment où sa position est connue.
Dans l’expérience de la double fente d’Einstein-Bohr, puisque toute interférence éventuelle avec un appareil de détection est définitivement exclue grâce au dispositif inventé par Einstein, on sait que si la fonction d’onde s’effondre au moment du passage par la fente, c’est que Bohr avait raison. Cet effondrement de la fonction d’onde n’a donc rien à voir avec une interférence physique avec l’appareil de mesure, qui alors n’existe plus. Bohr avait donc raison : tant que l’on ne connaît pas la position de la particule au niveau de la fente, elle reste dans un état de position indéterminée, conformément au principe d’indétermination d’Heisenberg. Elle existe sous la forme d’une onde, ce qui explique très bien pourquoi, si on ne cherche pas à déterminer sa position, cette onde peut passer simultanément par les deux fentes. Mais ce n’est que lorsqu’on effectue une mesure que l’état de la fonction d’onde se « réduit » à une nature corpusculaire et prend une position précise dans l’espace. Ce changement de comportement montre que la réalité quantique est modifiée par l’acte même de connaître ou de ne pas connaître la position de la particule.
C’est exactement ce que l’expérience de la double fente mobile montre. Lorsqu’une particule passe à travers deux fentes sans qu’on mesure par où elle passe, elle forme un schéma d’interférence, comme une onde. Mais dès qu’on cherche à savoir par quelle fente elle est passée, ce schéma disparaît et la particule se comporte comme une particule classique, avec une trajectoire définie.
Cet effet prouve que, contrairement à des objets macroscopiques comme la Lune, les particules quantiques ne possèdent pas de caractéristiques définies tant qu’elles ne sont pas observées. L’observation modifie l’état du système quantique. Ce n’est pas simplement un manque de connaissance, mais une caractéristique étrange et fondamentale du monde quantique : l’indétermination n’est pas une limite de notre capacité à connaître, mais une propriété essentielle du système.
Avant la mesure, une particule quantique n’a pas de position et de vitesse définies. Elles ne sont pas simplement ignorées, elles n’existent pas sous ces formes tant qu’une connaissance de leur position ne les fixe pas. L’acte de mesure ne relève pas d’un simple constat, il crée la réalité quantique en détruisant les autres possibilités superposées, et c’est exactement cela que semble démontrer l’expérience proposée par Einstein.
Mise en garde
Je tiens à préciser avec toute modestie que cet article est le fruit de ma propre compréhension de cette expérience, aidée par l’IA, et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un domaine dans lequel je serais expert. Ce qui m’a poussé à approfondir ce sujet, c’est le constat que, malgré l’importance majeure des résultats obtenus, très peu d’articles ont été rédigés à ce sujet, et ceux que j’ai pu lire m’ont souvent semblé confus ou imprécis. Face à cette difficulté à trouver une explication claire et accessible, j’ai voulu explorer cette expérience en profondeur afin d’en proposer une présentation détaillée, qui, je l’espère, permettra de mieux en saisir les enjeux et les implications.
Cet article est libre de droit à condition de mentionner la source : https://dichotomieresolue.jimdofree.com/