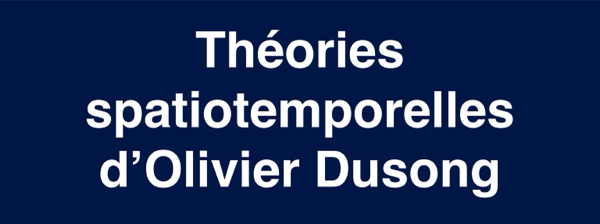Quelle est la nouveauté du Tempovect ?
©️Olivier Dusong 2024
Ce qui est nouveau dans ma proposition, c’est l’idée que l’annulation du temps pour un photon démontre la “vitesse du temps”. Plutôt que de simplement constater que le temps se fige à la vitesse de la lumière, sans explication, je propose d’interpréter ce phénomène comme la manifestation d’une limite à la vitesse du temps lui-même. Pour un photon, le temps ne s’écoule pas, ce qui montre que le temps a une “vitesse” propre : le Tempovect.
Cette interprétation est une vraie nouveauté, non pas parce qu’il n’y a pas de preuves que le temps ralentit et s’arrête à la vitesse C – cela est déjà découvert et empiriquement vérifié – mais parce que j’interprète ce ralentissement progressif comme le rattrapage de la vitesse du temps lui-même.
Je pense que cette idée est aussi simple que logique. Ce n’est pas une découverte en soi, puisque l’on sait déjà qu’à cette vitesse le temps s’arrête. Ce qu’il y a de nouveau ici, c’est d’interpréter cet arrêt comme le fait que la vitesse du temps ne peut plus suivre. Cette interprétation me paraît utile, en accord avec la relativité, et élégante pour mieux expliquer le phénomène de la limitation de la vitesse de la lumière et pourquoi le temps ralentit lorsque l’on s’approche de C. Cela dépasse l’idée abstraite de dilatation temporelle, souvent contre-intuitive, que même des scientifiques peinent parfois à comprendre tant elle s’éloigne de notre logique.
Avec le Tempovect, tout devient plus simple et logique : on comprend pourquoi rien ne peut dépasser C et pourquoi le flux du temps change en fonction de la vitesse dans l’espace. Cette réintégration dans la relativité restreinte introduit l’idée que la vitesse du temps – puisqu’elle s’arrête à C – est une constante universelle qu’il faut nommer : le Tempovect.
Le Tempovect, ou vitesse universelle du temps, ne doit pas être confondu avec le flux du temps, qui, lui, est fluctuant. Sans cette notion, la relativité restreinte sait parfaitement prévoir et calculer le ralentissement du temps, mais ne peut expliquer que ce ralentissement est précisément dû au rattrapage du Tempovect.
Ainsi, le Tempovect pourrait devenir non seulement un outil pédagogique pour expliquer la relativité au grand public, mais aussi une clé pour résoudre certaines interrogations fondamentales. Sans le Tempovect, la relativité restreinte restera toujours une théorie très contre-intuitive. Avec lui, elle pourrait être comprise sous un jour totalement nouveau.
Le Tempovect permet aussi de réinterpréter la relativité : plutôt que de voir le temps varier seulement en fonction des référentiels, on peut comprendre ces variations comme des écarts par rapport à une vitesse universelle connue, celle du Tempovect. Cela ne remet pas en question la relativité des flux temporels, mais introduit une mesure absolue, un cadre temporel universel qui impose des limites aussi bien au temps qu’à C.
Avec le Tempovect, la relativité est vue non seulement comme une question de mesure relative, mais comme une conséquence directe d’un cadre temporel universel, une constante globale : le Tempovect, qui impose des limites à l’écoulement du temps et à C.
En d’autres termes, avec le Tempovect, la relativité devrait être comprise non seulement comme une question de mesure relative entre les référentiels, mais comme une conséquence directe des limites imposées par le Tempovect. Plus nous avançons vite, plus nous nous rapprochons de la vitesse universelle du Tempovect, et plus le flux du temps se dilate et ralentit. Cela permet d’expliquer que le flux du temps dépend directement de la proximité ou de l’éloignement par rapport à cette vitesse universelle.
Ainsi, il devient évident que le ralentissement du temps est une conséquence naturelle du rapprochement avec le Tempovect, ce qui explique également pourquoi le temps se réduit proportionnellement à l’espace parcouru. Ce n’est donc pas que C impose une vitesse limite, mais bien que le Tempovect détermine cette limite, dictant à C la frontière qu’elle ne peut dépasser.