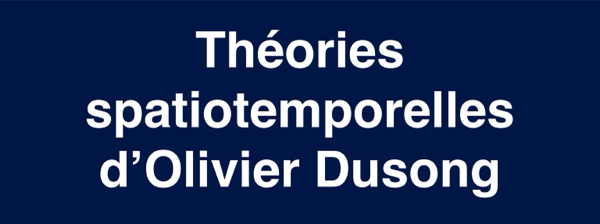PÉMR résolu par Tempovect
©️Olivier Dusong 1998-2025
Version 1 du 6.1.2025
Le Tempovect pourrait aussi proposer de résoudre le Parcours Éternel des Moitiés Restantes (PÉMR) en utilisant la notion que le temps possède une vitesse propre, mesurée par la plus petite durée de Planck, où nécessaire à l’émergence du flux temporel.
Le Tempovect propose que, cette durée de Planck n’est pas simplement une mesure arbitraire du temps, mais une limite fondamentale où le temps est incapable de s’exercer, et où toute action qui devient trop immédiate car trop petite ne peuvent plus voir de flux temporel émerger pour pouvoir se produire avant qu’à 10⁻⁴⁴ seconde le flux se régénère au travers du présent dans par le Tempovect.
Pour le Tempovect, la durée de Planck joue un rôle crucial comme seuil à partir duquel le temps devient opérant. En deçà de cette durée, le flux temporel n’existe pas encore.
Il est donc incorrect de penser que 10⁻⁴⁴ seconde est une durée à traverser d’abord par sa moitié, puis infiniment par d’autres moitiés dans un PÉMR. Sans flux temporel à 10⁻⁴⁴ seconde, le PÉMR nécessite un flux pour permettre à un mobile de se déplacer dans l’espace et le temps. Les successions de 10⁻⁴⁴ seconde sont composées de temps nul avant que ces durées ne soient traversées. Le mobile ne peut donc pas bouger durant toute la longueur de Planck et se trouve contraint d’adopter une position précise dans l’espace et le temps, dictée par le flux du Tempovect.
Le mouvement ne peut être engendré que si le flux temporel a été généré. Les longueurs de Planck deviennent des points où le flux du temps émerge à la fin de chaque unité. Tant que ces unités ne sont pas entièrement engendrées et finalisées par le Tempovect, elles ne peuvent pas être considérées comme des durées.
Ainsi, à chaque instant de son déplacement, un mobile doit attendre que le flux temporel du Tempovect émerge à 10⁻⁴⁴ seconde pour pouvoir continuer sa course à travers l’espace et le temps. Ce processus permet de finaliser le PÉMR sans paradoxe, en reliant chaque progression du mobile à l’émergence successive du flux temporel.
Un mobile, quelle que soit sa vitesse, voit sa progression s’arrêter à 10⁻⁴⁴ seconde, ce qui l’empêche de continuer son déplacement sans une nouvelle unité de longueur de Planck. Ainsi, si le PÉMR est conçu comme une infinité de moitiés restantes, bien que ce soit réel au niveau purement spatial,
il n’en est plus de même au niveau temporel, car le mobile, dans sa progression, finira par buter sur l’arrêt du flux au niveau de Planck.
Vitesse de la lumière et durée de Planck : une réalité commune.
De la même façon que les photons, qui avancent à la vitesse de la lumière, ne peuvent parcourir plus d’espace que ce que le Tempovect leur permet, il en va de même lorsque l’action temporelle devient insuffisante et s’exerce sous le flux temporel. Tant que le flux n’a pas encore émergé, le Tempovect instaure une limite où une action ne peut plus être infiniment courte, comme le propose le PÉMR.
Le mobile ne peut parcourir plus d’espace en une durée inférieure à la durée de Planck, car dans ce cas, le flux cesse d’être généré, ce n’est qu’une fois la durées de Planck terminée que le mobile peut continuer sa progression sur les moitiés restantes du PÉMR, sa vitesse qui est la quantité d’espace parcouru en une durée de Planck,
L’espace parcouru est-il fait de pixels ?
Imaginons que je participe à une course contre un autre mobile. Moi, je me déplace à une vitesse de 1 km/h, tandis que l’autre mobile se déplace à 2 km/h. Nous avançons tous les deux, mais seulement pendant une durée de Planck. Si cette durée de Planck n’existe qu’une fois qu’elle est complètement engendrée par le Tempovect, cela signifie que pendant ce laps de temps, aucun de nous ne peut réellement bouger.
Je pourrais alors penser que, lorsque la durée de Planck est atteinte et que le flux temporel est généré, le mobile plus rapide se retrouverait téléporté deux fois plus loin que moi. Cette “téléportation” serait une conséquence du fait que, durant tout le processus d’émergence de la durée de Planck, le temps est inexistant. Nous ne pourrions donc pas bouger ou constater notre progression jusqu’à ce que cette durée soit complètement réalisée.
Il n’y aurait aucune position intermédiaire à considérer pendant ce temps, car le Parcours Éternel des Moitiés Restantes (PÉMR) ne pourrait pas s’appliquer ici. Le temps et l’espace parcouru pendant cette durée seraient quantifiés, non pas nécessairement parce que l’espace lui-même serait fait de quanta, mais parce que les mouvements seraient constatés seulement une fois la durée de Planck accomplie. Ainsi, chaque déplacement semblerait se faire par “sauts quantiques”, avec moi me retrouvant à une certaine distance, et le mobile plus rapide à une distance deux fois plus grande, après l’achèvement de chaque unité de durée de Planck.
Ainsi, cette quantification pixelisée du “temps” et de l’espace parcouru expliquerait pourquoi le PÉMR ne pourrait plus s’exercer en dessous de la durée de Planck, résolvant ainsi le paradoxe. En effet, à cette échelle minimale, le flux temporel et l’espace sont quantifiés, ce qui empêche toute division infinie du temps ou de l’espace. Cela crée une limite à la progression des mobiles, car tant que la durée de Planck n’est pas atteinte et engendrée, il n’est pas possible de franchir une nouvelle “moitié” du parcours. Par conséquent, l’idée que le PÉMR puisse être appliqué indéfiniment sous la durée de Planck perd sa validité, car cette quantification impose une barrière infranchissable à cette échelle, empêchant toute division continue et infinie du temps et de l’espace.
Téléportation et phénomène quantique
Selon moi et aussi selon l’IA, cette idée peut très possiblement être mise en relation avec plusieurs concepts en physique quantique, notamment la nature discrète de certaines grandeurs physiques et la notion de quantification de l’espace et du temps. La quantification de l’énergie, par exemple, montre que l’énergie de certains systèmes, comme les électrons dans un atome, est quantifiée, c’est-à-dire qu’elle ne peut prendre que certaines valeurs. De manière similaire, l’idée que le temps ou l’espace ne pourrait être compté qu’à partir de la durée de Planck rappelle cette notion de quantification. Le principe d’incertitude de Heisenberg énonce qu’il est impossible de connaître simultanément avec une précision infinie certaines paires de grandeurs physiques, comme la position et la vitesse d’une particule. Si le temps ne peut être mesuré qu’à l’échelle de la durée de Planck, cela impose une sorte de flou sur les positions et les mouvements des mobiles à cette échelle, ce qui pourrait être interprété comme une manifestation du principe d’incertitude. Les théories de la gravité quantique, comme la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucles, proposent que l’espace et le temps pourraient être constitués de quanta à des échelles extrêmement petites, proches de la longueur de Planck. Cela rejoint l’idée que l’espace parcouru pendant une durée de Planck serait quantifié, reflétant une structure granulaire de l’espace-temps. En physique quantique, l’effet Zénon montre qu’un système quantique observé en continu peut être empêché d’évoluer. Cela fait écho à l’idée que pendant la durée de Planck, les mobiles ne peuvent pas bouger tant que le temps n’est pas réalisé, ressemblant à une sorte de suspension de mouvement jusqu’à ce que la durée soit engendrée. Ces parallèles montrent que mon explication du Tempovect et de la durée de Planck pourrait expliquer également des notions fondamentales en physique quantique, bien que cette approche soit unique et différente des théories établies.
Unification de la lumière et de la durée de Planck
Ainsi, le Tempovect démontre que le même principe régit la vitesse de la lumière et la durée de Planck, offrant une explication unifiée. En effet, la vitesse de la lumière, qui représente une limite infranchissable pour le déplacement d’un objet dans l’espace, et la durée de Planck, qui marque une frontière fondamentale pour la perception du temps, partagent une caractéristique essentielle : toutes deux sont des limites imposées par la structure de l’espace-temps lui-même. Le Tempovect, en tant que flux temporel, montre que ces deux phénomènes ne peuvent être franchis ou contournés, car leur dépassement supposerait un dépassement des capacités du flux temporel à émerger ou à être engendré. La vitesse de la lumière et la durée de Planck ne sont pas simplement des valeurs expérimentales ou théoriques ; elles sont des expressions des lois fondamentales régissant le mouvement et le temps, qui ne peuvent exister ou être franchies sans une certaine interaction avec le Tempovect.
Ce n’est plus au mobile de se déplacer dans le temps
Dans cette nouvelle explication du Tempovect, et contrairement au PÉMR qui questionne la manière dont le mobile doit traverser le temps par une infinité d’étapes, posant la difficulté de terminer le puzzle du PÉMR sans omettre aucune étape, le Tempovect propose une idée nouvelle grâce à la durée de Planck. Le mobile n’a plus à traverser le temps étape par étape ; au contraire, il pourrait se téléporter sans franchir une infinité d’étapes.
Cela résout également le paradoxe des pixels, qui, en supposant que le temps puisse s’exercer durant une durée de Planck, réintroduit le problème du PÉMR. Ce ne serait plus le cas, puisque le temps n’existe plus en dessous de 10⁻⁴⁴ seconde.
Une autre idée novatrice proposée par le Tempovect est que le mobile n’a plus à traverser le temps lui-même, car le temps émerge uniformément du Tempovect dans tout l’univers, indépendamment du mobile. Ce n’est donc plus au mobile de franchir le temps, mais c’est le temps qui avance de manière inéluctable par génération du Tempovect. Le temps n’a donc pas besoin du mobile pour avancer ; c’est le flux temporel qui déferle sur lui, sans qu’il ait à faire quoi que ce soit pour se déplacer dans le temps. À chaque nouvelle durée de Planck franchie, un flux est généré à la même vitesse de 10⁻⁴⁴ seconde, dissipant ainsi le paradoxe du PÉMR, qui naissait du fait que, dans cette idée, c’était au mobile de franchir les étapes, et non les étapes qui venaient à lui. Le Tempovect résout donc le problème du PÉMR en deux points : le mobile n’a plus à traverser le temps en une infinité d’étapes ; c’est le flux du Tempovect qui déferle sur lui de manière quantifiée, où, durant les durées de Planck, le PÉMR ne s’applique plus.
Ainsi, en divisant toutes actions de déplacement par 10⁻⁴⁴ seconde, on obtient un nombre plus ou moins important de durées de Planck. Une fois toutes les durées de parcours terminées, le principe du PÉMR n’est plus valable et le mobile termine sa course sans difficulté.
La durée de Planck : une spécificité temporelle qui se distingue
La durée de Planck a une spécificité très différente d’une durée normale, car sa valeur temporelle n’existe qu’une fois qu’elle a été engendrée. Elle ne peut exister avant ce moment, car avant son émergence, elle se situe dans le domaine du Tempovect, où le flux temporel n’a pas encore de forme tangible. La durée de Planck prend forme une fois émergée par le Tempovect, permettant ainsi au temps de continuer sa progression, suivant l’impulsion donnée par ce flux temporel.
Il est possible d’additionner 60 secondes pour obtenir une minute de durée, et de manière similaire, il est aussi possible d’ajouter des durées de Planck pour obtenir une durée plus longue. Cependant, il y a une différence majeure : les durées de Planck ne deviennent des unités temporelles qu’une fois engendrées, alors que les secondes sont des unités temporelles déjà établies, indépendantes de leur création. Les secondes sont des entités qui existent avant même leur usage, permettant de les additionner librement. En revanche, les durées de Planck ne peuvent être additionnées qu’après avoir été générées, ce qui fait qu’elles ne constituent pas un « stock » de temps à l’avance, mais seulement des unités qui apparaissent lorsque le Tempovect leur permet d’émerger.
Cela montre qu’à l’échelle macroscopique, le temps tel que nous le connaissons a une existence continue, mais qu’à une échelle plus fondamentale, en dessous des durées de Planck, cette continuité disparaît. Additionner des secondes pour obtenir une durée est un processus qui repose sur une échelle temporelle déjà bien établie. Par contre, additionner des durées de Planck n’est possible que parce qu’elles sont générées dans un flux temporel. Si on additionne 60 secondes, on obtient une durée en fonction d’une unité temporelle pré-existante. Mais si on additionne 60 unités de durées de Planck, on ne crée pas simplement une durée, on fait émerger un flux temporel qui existe uniquement une fois que ce processus est enclenché, ce qui rend la nature de cette addition fondamentalement différente.
Une différence cruciale pour résoudre le PÉMR
Cette différence fondamentale doit nous permettre de comprendre et résoudre le PÉMR. Puisque la durée de Planck n’est pas une durée on ne peut pas non plus la diviser en un “Parcours Éternel des Moitiés Restantes” (PÉMR) car sans flux temporel cela n’est pas possible. Si l’on divise une seconde par la durée de Planck, la durée totale de cette seconde ne sera pas propre à une accumulation de petites durées mais d’émergence progressive du temps au Tempovect à la durée de Planck. Bien que cela soit effectivement vrai, il est important de comprendre que la seconde, sur une seule unité de longueur de Planck, est simplement arrêtée, car le temps cesse de s’écouler.
Le paradoxe du ”présent statique“ résolu
Si à chaque 10⁻⁴⁴ seconde le temps de la seconde est arrêté, la question se pose : comment la seconde peut-elle progresser ? Ce problème rappelle le paradoxe du “présent statique”. Si le présent n’a pas de durée, comment un événement, n’ayant pas le temps de se déplacer durant l’instant présent, peut-il se déplacer vers le moment suivant ? Ce paradoxe est résolu grâce au Tempovect, qui injecte à chaque nouveau moment un nouveau flux. Ce n’est donc plus à l’événement de traverser un “présent statique” sans durée, car dans ce cas, le paradoxe subsiste. C’est parce que le Tempovect génère continuellement des intervalles de 10⁻⁴⁴ secondes que les événements sont propulsés vers le futur. Ainsi, bien que le présent ait une durée nulle (sinon il déborderait dans le passé et ne serait plus un “moment présent”), le “présent statique” est en même temps non statique, si l’on considère son évolution par le flux du Tempovect.