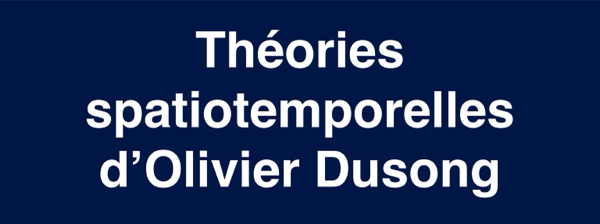L’inflation, une lacune à résoudre l’isotropie du CMB ?
Cet article s’adresse à ceux qui ont déjà lu :
Article précédent
Version 1 du 28.11.2024
©️ Olivier Dusong 1998-2024
L’horizon cosmologique est la limite de l’univers observable, définie par la distance maximale parcourue par la lumière depuis le Big Bang. Il délimite une bulle autour de nous, au-delà de laquelle aucune information ne peut nous parvenir en raison de la vitesse finie de la lumière. Cela pose le problème de l’horizon : comment des régions de l’univers, séparées par des distances si vastes qu’elles n’ont jamais été en contact causal, peuvent-elles présenter une telle homogénéité dans le fond diffus cosmologique (CMB) ?
Le CMB révèle une répartition étonnamment homogène de la matière et de la température dans toutes les directions du ciel, ce qui pose un problème majeur. Si des régions éloignées de l’univers n’ont jamais été en contact causal à cause des distances immenses séparées par l’horizon cosmologique, elles n’auraient pas pu échanger d’informations ou s’influencer mutuellement, et de fortes disparités dans la distribution de la matière dans l’univers auraient dû casser le modèle homogène du CMB. Cela souligne une contradiction majeure, car ces régions montrent des caractéristiques presque identiques. Comment expliquer qu’elles aient pu atteindre un tel équilibre sans interaction possible ? Ce paradoxe, connu sous le nom de problème de l’horizon, soulève l’idée qu’un échange d’informations aurait été nécessaire. Pourtant, cela devrait être impossible selon la relativité générale, en raison de la vitesse limite de la lumière.
Pour résoudre ce problème, le modèle standard Lambda a introduit l’idée d’une phase d’inflation cosmique extrêmement rapide, qui aurait permis à toutes les régions de l’univers d’échanger toutes les informations très rapidement après la singularité.
Selon cette hypothèse, une période d’inflation, juste après la singularité, aurait permis aux régions de l’univers observable, alors proches, d’interagir et d’échanger de l’information. Cette phase aurait pu expliquer une homogénéité thermique et isotrope avant que l’univers ne s’étende rapidement, figeant ainsi cette uniformité. Mais je me demande si cela est réellement suffisant pour expliquer l’isotropie extrême du fond diffus cosmologique (CMB). Si je pense cela, c’est parce que, même en acceptant cette hypothèse, et même si le lissage était absolument parfait, je me pose une question importante.
Si nous ne sommes pas exactement au centre de la “bulle 3D” définie par le CMB, nous devrions observer une asymétrie dans la répartition de la matière, avec des différences selon la direction observée, notamment dans les directions où il y a plus de matière. Mais cela n’est pas observé : le CMB est isotrope, indépendamment de la direction d’observation adoptée. Ce simple fait est contradictoire. À moins d’être par hasard exactement au centre de l’expansion, nous devrions constater des écarts majeurs dans la densité de matière du CMB.
En revanche, si l’on se met à concevoir que la singularité du Big Bang n’a pas lieu en un seul endroit privilégié en 3D mais sous une omniprésence dans la 5D, il serait alors parfaitement normal que la singularité soit répartie de façon parfaitement homogène dans l’univers entier.
Cette idée peut être renforcée par l’hypothèse de la “Matière 5D” engendrée par la nature même du vide, présent partout de manière égale dans l’univers de l’avant Big Bang. Dans cette perspective, “l’expansion 5D” émerge et pourrait sans difficulté expliquer cette homogénéité sans avoir à recourir à un lissage hypothétique du CMB par l’inflation.
Dans ce cadre, l’uniformité du CMB serait une conséquence naturelle des conditions initiales homogènes et isotropes de la singularité qui, puisque elle aurait existé de façon homogène partout dans l’univers, expliquerait en quoi le rayonnement de corps noir du CMB serait parfaitement homogène dans toutes les directions du ciel sans nécessiter d’échange d’informations ni d’hypothèses spéculatives non conformes à l’isotropie du CMB.