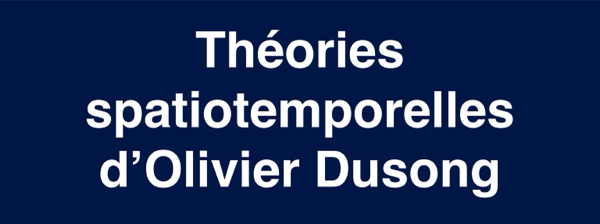Les limites du modèle standard de l’univers et l’apport potentiel de la 5D
©️Olivier Dusong 1998-2024
Version 3 du 8.12.2024
Le Big Bang s’est fait partout à la fois
On entend souvent dire que le Big Bang ne s’est pas produit en un point unique de l’espace, mais partout à la fois. C’est une idée issue du modèle standard Lambda, qui est le modèle le plus couramment accepté aujourd’hui pour proposer une explication à l’apparition de l’univers et son évolution jusqu’à nos jours. Ce modèle Lambda est en constante évolution et pourrait être enrichi au fil du temps.
Cependant, ce “partout à la fois” prôné par ce modèle, a toujours suscité en moi plusieurs interrogations profondes, malheureusement rarement relevées.
Comment une expansion pourrait-elle être “partout à la fois” si l’univers était supposément contenu dans un état extrêmement réduit au moment de l’événement initial ?
Si l’on postule que l’univers était minuscule, il est logique de concevoir une expansion qui s’effectue depuis un volume limité, et dans ce cas, comment peut-on parler d’un partout à la fois ?
En revanche, si l’expansion s’est produite “partout à la fois”, cela n’est possible que si l’espace n’est pas limité à un volume et qu’il est infini, car tant qu’un espace est limité, alors le Big Bang se serait produit qu’à ce volume. Ces deux idées semblent alors singulièrement contradictoires.
On dit aussi que le Big Bang n’est pas parti d’un centre, mais si l’univers était minuscule, il aurait nécessairement dû être limité par des bords et avoir un centre.
En revanche, si l’univers est infini, l’idée de “partout à la fois” devient parfaitement envisageable. Un espace sans centre ni bord ne limite pas l’expansion à un volume précis et dans ce cas seulement, le partout à la fois n’est plus contradictoire.
Cependant, inversement, il est également dit que l’espace lui-même est en expansion, mais si l’espace est infini pour respecter le “partout à la fois”, cela me pose un énorme problème logique.
En effet, comment un espace infini pourrait-il s’étendre plus qu’il n’est déjà étendu à ses “non bord” ?
Cela pose un paradoxe, car l’infini ne peut pas être en expansion, l’idée d’expansion n’est possible que si un univers est fini. Mais dans un univers sans bord, l’idée d’expansion perd tout sens.
On entend que c’est l’espace lui-même qui s’étire, or si l’espace est infini, il ne peut pas s’étirer. En revanche, si l’on postule que l’espace de l’univers était minuscule mais qu’il se limitait à un volume fini juste après le Big Bang, il faudrait que l’espace s’arrête à des bords, ce qui réintroduit l’idée d’un centre et pose une question dont la théorie du modèle Lambda est incapable de répondre : qu’y avait-il autour de cet espace ?
Tentative d’explications
Une explication couramment utilisée pour tenter de répondre à cette question est de dire qu’à l’ère de la singularité, ni l’espace ni le temps n’existaient encore. Dans ce cadre, la question de ce qu’il y avait autour n’a plus de sens puisque l’espace tel que nous le concevons n’existait simplement pas à l’ère du mur de Planck.
Cependant, cette explication est, pour moi, insatisfaisante, puisque cet état de la singularité sans espace ni temps n’est plus tenable une fois l’univers sorti de cette singularité. Si l’on postule que l’univers après le Big Bang est sorti de cette singularité de l’ère de Planck où l’espace n’existait pas,
dès lors, cette argumentation que l’espace n’existait pas ne tient plus dans l’univers post-Big Bang. Dès que l’univers s’est suffisamment dilaté et s’est refroidi, il a atteint un volume où les conditions extrêmes du début se sont apaisées et où l’on sait avec certitude que l’espace 3D et le temps 4D sont apparus.
Sitôt les 3D existent, même à supposer que l’expansion de la matière de l’univers était limitée à une « bulle 3D », les 3D permettraient nécessairement de mesurer des espaces tant en dedans de cette bulle qu’en dehors. Même si l’expansion de l’univers au niveau matériel était limitée, dans un volume fini, dès que les 3D existent, ils devraient nécessairement exister tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la “bulle”.
Ce qui serait en contradiction avec l’homogénéité du CMB, les 3D s’appliqueraient nécessairement également à l’infini en dehors de la bulle, quelle que soit la composition de l’univers en matière ou en vide.
C’est pourquoi penser que l’univers matériel s’étendait comme un ballon de baudruche et qu’à l’extérieur de ce ballon il n’y aurait simplement pas d’espace, ce qui est souvent confondu avec la singularité, ne me semble pas crédible.
Ainsi, sitôt que l’univers est sorti de la phase de la singularité, dès que l’espace et les 3D existent, alors cette “trame 3D” doit nécessairement s’appliquer au reste de l’univers.
Utiliser les incertitudes de la singularité pour prétendre que l’espace devrait s’arrêter magiquement à une “bulle 3D” et qu’il n’existerait pas à l’extérieur de la bulle reste non seulement inexpliqué mais en plus d’être illogique. Cette hypothèse reste purement spéculative. Si tel était le cas, l’explication de la singularité du début de l’univers resterait insatisfaisante et probablement erronée puisque si les 3D existent, c’est nécessairement que l’on est sorti de la singularité. L’explication ne tient donc plus.
Un univers infini comme solution au paradoxe
La seule manière de concilier l’idée d’un “partout à la fois” avec le modèle cosmologique serait de supposer un univers infini dès le départ. Dans un espace sans bord ni limite, chaque point de l’univers aurait pu être impliqué dans l’événement initial, ce qui correspondrait à l’idée d’un phénomène simultané et global.
Cependant, cette hypothèse soulève d’autres questions. Si l’univers est infini dès l’apparition des 3D, l’idée même d’une “expansion de l’espace” devient inapplicable. L’espace infini ne s’étire pas ; seule la répartition de la matière à l’intérieur de cet espace pourrait être interprétée comme une expansion.
Cela implique que ce que nous percevons comme une expansion de l’univers ne serait en réalité que la distribution progressive de la matière dans un espace déjà infini. Cette dispersion obéit à des lois telles que celle de Hubble-Lemaître, mais ne concerne pas l’espace lui-même, qui demeure infini et immuable dans ses dimensions.
Confondons nous l’espace et l’expansion ?
C’est alors une question que l’on pourrait se poser. On pourrait proposer qu’il pourrait être utile de faire la distinction entre deux notions distinctes, ce qui à ce jour est couramment confondu.
1. L’expansion de la matière dans l’univers.
2. L’expansion de l’espace lui-même.
Si l’univers est fini, cette hypothèse est en contradiction avec l’idée d’un “partout à la fois”. Dans ce cas, l’expansion ne peut se produire qu’à partir d’un volume limité. En revanche, si on postule un partout à la fois, cela n’est plus possible dans un espace réduit, et dans ce cas, l’univers est infini. Cela rend non seulement le partout à la fois possible, mais dans un univers infini, puisque l’infini ne peut s’étirer davantage que l’infini, seule la distribution de la matière peut être finalement qualifiée d’expansion. Mais si l’univers était infini, il ne pourrait pas être en expansion plus qu’il est déjà étendu à ses “non bord”.
Si l’infini n’est pas mesurable en 3D, c’est que l’infini n’appartient plus à la 3D. Ainsi, comprendre que l’infini appartient à une dimension supérieure à la 3D, comme cela est expliqué dans mes théories, permet de comprendre que l’idée d’une expansion n’est pas possible envers l’infini, car l’infini est une dimension sans bord, et évidemment l’idée d’endroit dans une telle dimension n’existe plus. Mais si la 5D de l’infini est sans bord, cela nous permet de saisir ce que l’on peut déjà comprendre avec la notion de l’infini. Évidemment, l’infini 5D ne peut être en expansion, contrairement à la densité matérielle ; l’infini étant infini ne peut s’étendre plus qu’il n’est déjà étendu au maximum à ses “non bord”.
Ainsi, pour que l’idée de “partout à la fois” ait un sens, pour moi, il faut nécessairement envisager un espace infini dès l’origine, ce qui remet en question l’idée que l’univers entier était contenu dans un volume minuscule. C’est ici que je propose d’interpréter que ce volume minuscule ne concerne qu’une partie de notre univers local, mais que cette singularité ne se serait pas faite qu’à un seul endroit, mais dans la totalité de l’univers infini en 5D. Seul un tel modèle est en accord avec l’affirmation que l’univers s’étend partout à la fois et que le Big Bang n’est pas parti d’un point mais s’est fait depuis tout point de l’univers, une affirmation également soutenue par le modèle Lambda. Ainsi, si la répartition matérielle se disperse bel et bien conformément au redshift, cette expansion ne concerne pas l’espace lui-même, mais la répartition de la matière qui se dilate sur une “trame 3D” au sein d’une dimension invisible et plus vaste : l’infini 5D.
Cette hypothèse que je propose s’appelle “L’expansion 5D”. Cela permet d’éliminer les contradictions liées à la notion de centre ou de frontière et de clarifier les ambiguïtés du modèle Lambda toute en le complétant.
Si ma proposition tient, il faudra alors éviter de dire à l’avenir que l’univers était autrefois minuscule, sans préciser que cette singularité minuscule ne concernait qu’une partie infime de la totalité de l’univers et que, si cette singularité s’est produite en un endroit, elle aurait dû également se produire de façon identique en tous points de l’univers. Seul un tel modèle peut soutenir l’idée d’une expansion totale, sans centre ni endroit, d’un partout à la fois dans l’infini 5D.
La 5D devient alors un élément facilitant la compréhension de notre modèle Lambda, car sans la 5D, on ne peut comprendre dans quelle structure dimensionnelle la singularité aurait dû s’exercer ni comment un partout à la fois est possible, sauf dans une dimension spatiale ultime sans bord, où la notion d’endroit, de bord ou de centre n’a plus lieu d’être.
Cette dimension supplémentaire explique pourquoi et comment le modèle Lambda a probablement raison d’affirmer que le Big Bang ne s’est jamais fait en un lieu précis, mais qu’il s’est effectivement produit partout à la fois dans un univers infini dès le départ.
“L’expansion 5D”
En revanche, l’affirmation que l’univers entier était contenu dans une singularité limitée à un volume minuscule ne tient pas avec un partout à la fois.
La métaphore du ballon de baudruche une mauvaise métaphore ?
La métaphore du ballon de baudruche, couramment utilisée de nos jours dans la vulgarisation scientifique, laisse peut-être entendre une erreur d’interprétation, comme si l’univers s’était étendu dans un espace limité. Cette image, bien que pratique pour expliquer l’expansion de l’univers, pourrait également être extrêmement trompeuse, car elle donne l’impression que la surface du ballon représente l’espace observable, tandis que l’intérieur et l’extérieur du ballon seraient des zones où l’espace n’existe simplement pas. Pour moi, cette analogie est trompeuse, car elle suggère implicitement que l’expansion de l’univers se fait dans quelque chose, ce qui contredit la notion fondamentale du partout à la fois.
Si l’expansion est réellement partout à la fois, elle ne peut pas concerner une surface en 2D à la surface d’un ballon, car cette surface est finie et non en 5D, ce qui ne correspond absolument pas à l’affirmation du modèle Lambda selon laquelle l’univers est en expansion partout à la fois. Évidemment, si l’univers est infini dès son début, alors il ne peut pas s’étendre de manière comparable à un ballon. Même comme métaphore, cette image est mal choisie, car un infini ne peut ni se dilater ni se contracter. Dans ce cadre, l’expansion ne concernerait pas l’espace lui-même, mais la distribution relative de la matière au sein de cet espace infini.
De plus, si l’univers est homogène et isotrope à grande échelle, comme le suggère le rayonnement fossile (CMB), alors l’expansion se produit simultanément dans toutes les directions et en tous points. Il n’existe ni centre ni bord d’où cette expansion pourrait commencer ou vers laquelle elle pourrait converger. Dans ce contexte, le modèle de l’univers infini dès l’origine s’accorde mieux avec les observations et élimine les incohérences liées à l’idée d’un ballon de baudruche.
Enfin, la métaphore du ballon tend à occulter la dimension fondamentale du vide dans la structure de l’univers. Si l’univers infini est composé de matière et de vide, alors l’expansion concerne uniquement la densité de matière, tandis que le vide lui-même, qui pourrait être associé à une dimension supérieure (comme la 5D), reste constant et sans bord. En d’autres termes, l’univers observable pourrait être vu comme un sous-ensemble en 3D évoluant dans une structure infiniment vaste en 5D, où la notion d’expansion ne s’applique qu’à une ”trame 3D” faite de vide parsemer de matière, mais cette expansion serait limitée qu’à la matière et aux 3D mais ne concernerait pas le vrai espace du vide lui-même puisque celui-ci s’étendrait dans un ”nul part” jusqu’au “non bord” de l’infiniment grand en 5D.
Ainsi, bien plus que de simplifier notre compréhension de l’univers, la métaphore du ballon de baudruche risque de détourner l’interprétation vers une compréhension tridimensionnelle limitée à un ballon de baudruche, alors que la dilatation de la répartition matérielle s’applique dans une dimension 5D sans bord. Ainsi, si dans notre monde en 3D nous voyons effectivement les galaxies s’éloigner les unes des autres, ce ne serait pas l’espace lui-même qui s’étirerait, mais uniquement la distribution matérielle au niveau 3D local.
Si l’univers s’étendrait partout à la fois en une “Expansion 5D” alors ce processus ne se serait pas produit dans un espace limité, mais dans une dimension infinie en 5D dès le départ. Cette dimension sans bord aurait servi de structure préexistante permettant l’émergence simultanée de la matière en tous points.
Cela rend possible l’idée que le Big Bang ne s’est pas déroulé en un lieu unique, mais partout à la fois, comme le suggère également le modèle Lambda.
Ainsi, l’univers en expansion que nous observons aujourd’hui n’est pas une expansion de l’espace lui-même, mais une réorganisation de la matière au sein de cette trame infinie qu’est la 5D. Ce cadre théorique permet d’éliminer les contradictions liées à la notion de centre ou de frontière, en accord avec l’idée d’un univers infini et sans bord.
Comment adapter la métaphore du ballon à l’expansion en 5D ?
Au lieu d’imaginer un seul ballon sur lequel des points (représentant les galaxies) s’étendent à mesure qu’il se gonfle, imaginons maintenant la 5D remplie de ballons dégonflés, se touchant bord à bord jusqu’au “non bord” de l’infini 5D. Chaque ballon représenterait un point précis sur la “trame 3D”, et il y aurait une quantité infinie de ces ballons. La singularité aurait eu lieu dans cet ensemble infini de ballons, s’étendant dans la 5D, illustrant le “partout à la fois” du modèle Lambda.
Si l’on remonte dans le temps, à environ 15 milliards d’années, en utilisant le redshift de la loi de Hubble-Lemaître, on peut imaginer que la matière était incroyablement dense, avec les galaxies proches les unes des autres. La singularité aurait englobé l’ensemble de l’univers 5D, déclenchant l’expansion simultanée de tous les ballons. Imaginez maintenant ces ballons se repousser constamment. Si l’on se concentre sur un seul ballon dans un espace 5D, la dilatation de l’espace à l’intérieur de ce ballon serait effectivement négligeable par rapport à l’expansion simultanée de tous les autres ballons. Cela s’explique par le fait que l’expansion de l’univers, telle qu’elle est perçue, ne se limite pas à une simple croissance locale d’un espace confiné, mais s’étend de manière uniforme à travers l’ensemble de cette structure infinie de ballons en 5D.
Dans ce modèle, chaque ballon représente un point dans la trame 3D de l’univers, et ces ballons sont disposés de façon infinie dans la 5D.
Explication de l’accélération de l’expansion de l’univers sans énergie noire.
Si l’on se concentre sur un seul ballon, il est important de comprendre que la dilatation de l’espace à l’intérieur du ballon, en tant qu’entité isolée, serait extrêmement faible par rapport à l’expansion globale du système des ballons dans la 5D. En d’autres termes, l’espace à l’intérieur du ballon s’étirerait, mais cet étirement serait minime, car l’espace contenu dans un seul ballon est très localisé et restreint.
En revanche, l’expansion simultanée de tous les ballons dans cette dimension supérieure (la 5D) augmente considérablement la distance entre chaque ballon. Chaque ballon, qui représente un point de l’univers dans cette analogie, se “repousse” naturellement des autres, car l’espace dans lequel ils sont immergés se dilate uniformément. Cela crée l’effet que nous observons à une échelle cosmologique : à mesure que l’on mesure les distances entre les galaxies (les ballons), ces distances augmentent, ce qui nous donne l’impression que l’univers s’étend de plus en plus vite.
Ce phénomène d’expansion accélérée s’explique par le fait que, contrairement à l’étirement d’un seul ballon en 3D, où la distance entre deux points à l’intérieur du ballon ne changerait pratiquement pas à moins que l’on s’éloigne de la zone de déformation, dans le cas des ballons en 5D, l’expansion se fait simultanément dans toutes les directions de manière continue. Chaque ballon “gonfle” de manière égale, mais vu de l’extérieur, l’espace entre eux semble croître de façon exponentielle. Plus les ballons sont éloignés, plus l’expansion devient perceptible et plus rapide. Cette accélération apparente de l’expansion de l’univers est le résultat de cette dynamique globale où l’espace inter-ballon se dilate en permanence, mais à une échelle beaucoup plus grande que la simple dilatation locale à l’intérieur d’un seul ballon.
En résumé, l’accélération de l’expansion que nous observons dans l’univers est directement liée à l’augmentation des distances entre les ballons dans cette 5D, et non à une expansion locale à l’intérieur d’un seul ballon.
Ce nouveau modèle offre une explication de l’accélération de l’expansion de l’univers qui ne nécessite pas l’introduction de concepts comme l’énergie noire. Dans ce cadre, l’expansion n’est pas causée par une force mystérieuse ou inconnue, mais résulte simplement de la dynamique inhérente à la structure de l’univers en 5D.
En 5D, l’expansion se déroule simultanément et uniformément dans toute la structure composée de ballons. À mesure que l’espace entre les ballons se dilate, les distances entre les points matériels (les ballons) augmentent de manière continue, ce qui donne l’impression d’une accélération de l’expansion. Cette accélération n’est pas le résultat d’une force extérieure ou d’une énergie noire, mais découle directement du fait que l’univers est en expansion dans une dimension supplémentaire (la 5D), ce qui permet à la distribution de matière d’évoluer à une échelle cosmologique.
Ainsi, le modèle de l’expansion en 5D propose que l’accélération observée est une conséquence naturelle de l’organisation de l’univers à une échelle supérieure, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des concepts qui demeurent encore mal compris dans le cadre du modèle standard.
La “Matière 6D”
La “Matière 6D” est une autre de mes propositions. Si l’univers préexistait à la singularité, il ne pouvait être que profondément vide, puisque seul ce vide existait pour le constituer. Ainsi, l’univers avant le Big Bang aurait nécessairement dû naître des propriétés physiques quantiques et dimensionnelles de ce vide. L’idée est que, conformément aux découvertes récentes, le vide n’est pas véritablement vide, mais est traversé par des champs d’énergie antiques faisant apparaître des particules immédiatement annihilées par leurs antiparticules. Dans un vide infini en 6D, cette dynamique aurait la capacité d’engendrer une énergie infinie, conduisant à la création de la singularité et, par conséquent, au Big Bang.
Bien que le pourquoi et le commencement demeurent totalement à expliquer, l’idée de la “Matière 6D” repose sur un principe assez simple. S’il n’y avait que du vide avant le Big Bang, il faut se rendre à l’évidence : c’est de ce vide quantique que le Big Bang et la matière ont dû émerger. C’est un postulat simpliste, mais logique si l’on considère qu’avant le Big Bang seul le vide préexistait. Néanmoins, cela reste une hypothèse à confirmer, bien que des idées similaires aient été explorées par certains physiciens théoriciens. Par exemple, la notion selon laquelle le vide quantique peut générer de l’énergie et de la matière grâce à des fluctuations quantiques rejoint des travaux comme ceux de Lawrence Krauss dans A Universe from Nothing, où il explore l’idée que l’univers peut émerger du vide quantique sans enfreindre les lois de la physique.
De manière plus générale, des théories liées à la cosmologie quantique, comme celles de Lee Smolin ou de Stephen Hawking, considèrent également que le vide pourrait être une structure dynamique à l’origine de la naissance de l’univers. Cependant, ces idées sont encore spéculatives et nécessitent des preuves empiriques pour valider leur pertinence dans un cadre cosmologique.