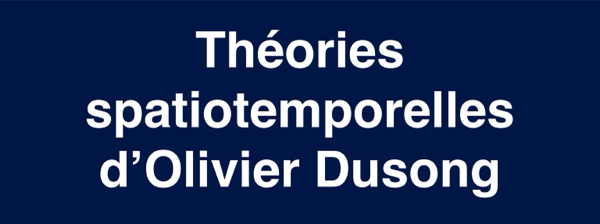L’expérience murale : L’éternité peut-il être expérimenté ? Chapitre 5
Ce chapitre s’adresse à ceux qui ont déjà lu :
Note : Ce chapitre suit l'évolution des théories. Version 3 datée du 14.6.2024
©️ Olivier Dusong 1998-2024
L’expérience du voyage mural est une expérience spatiotemporelle de pensée que j’ai imaginée pour explorer ce que serait notre conscience si elle pouvait pleinement embrasser l’éternité du PÉMR. Pour cela, nous entrons à bord de l’EterniGo, positionnés à 10 mètres d’un mur, avec une vitesse initiale nous permettant de couvrir cette distance en 2 secondes. Ensuite, la vitesse de l’EterniGo est modifiée de sorte qu’il nous faille toujours 1 seconde pour franchir la moitié restante du trajet.
Dans ce contexte, notre vaisseau pourrait avancer théoriquement à l’infini vers le mur sans jamais atteindre la dernière moitié, car les moitiés restantes se succéderaient de manière infinie sans épuiser la TMPT. Cette expérience de pensée nous permettrait ainsi de sonder l’éternité du PÉMR,
au-delà des contraintes imposées par notre perception limitée du temps.
Pour garantir que chaque moitié restante soit perceptible, nous pourrions également programmer l’EterniGo afin que notre stature se réduise proportionnellement à la taille de chaque nouvelle moitié restante.

Dans cette expérience, que percevrions-nous ? D’abord, la distance de 10 mètres entre nous et le mur semblerait rester constante, car notre stature diminuerait au même rythme que la réduction des moitiés restantes du Parcours Éternel des Moitiés Restantes (PÉMR). Nous aurions l’impression que notre environnement s’agrandit de manière infinie à mesure que notre taille diminue.
À notre échelle, il semblerait que nous continuions à avancer à une vitesse constante, comme si nous marchions sur place sur un tapis roulant. En regardant le mur, cependant, la distance restante paraîtrait toujours identique, comme si le mur s’éloignait à mesure que nous nous en approchions. Cette illusion découlerait de la réduction constante de notre taille, orchestrée par l’EterniGo.
L’EterniGo pourrait ainsi ralentir indéfiniment sans jamais s’arrêter, car tant qu’il existerait des moitiés restantes dans le PÉMR, nous devrions continuellement franchir chaque nouvelle moitié en une seconde.
Tout comme la métaphore du puzzle ou de la bibliothèque du PÉMR, l’expérience du voyage mural nous offre une nouvelle manière d’explorer les mystères du PÉMR.
Cette expérience nous aide à méditer sur l’obligation de traverser chaque moitié restante. La réduction progressive de la vitesse, d’une seconde pour chaque nouvelle moitié, illustre bien la nature paradoxalement éternelle du PÉMR.
Reproduction en laboratoire et simulation informatique
Cette expérience illustrerait que, bien que la distance entre nous et le mur soit limitée à 10 mètres, il pourrait théoriquement s’avancer éternellement vers ce mur sans jamais s’arrêter. Mais est-ce vraiment faisable ? Si tel est le cas, cela nous permettrait d’explorer la réalité éternelle du PÉMR au-delà des limites de nos TMPT.
Pour rendre cette expérience plus réaliste, supposons que nous remplaçons l’EterniGo par une machine robotique, une sonde réglée pour suivre cette même décélération éternelle. Serait-il vraiment possible de réduire sa vitesse indéfiniment sans que la sonde finisse par s’immobiliser complètement ?
En réfléchissant à cette question ou en réalisant une simulation informatique, il apparaît que, contrairement à l’expérience imaginaire de l’EterniGo, la réduction continue de la vitesse ne pourrait pas être mise en œuvre. À notre échelle humaine, nous pourrions constater que la sonde ralentirait encore et encore jusqu’à sembler s’immobiliser complètement. Cela serait normal, car au fur et à mesure que l’expérience se déroulerait, les distances deviendraient microscopiques et donc invisibles. Cependant, en zoomant indéfiniment sur les moitiés restantes avec un microscope suffisamment puissant, ne verrions-nous pas qu’une fois les moitiés redevenues visibles, la course microscopique de la sonde n’achève jamais sa progression ?
J'imagine sans certitude que les moitiés restantes, bien que microscopiques, continuent d’exister. Ma logique primaire m’indique que la sonde devrait poursuivre son mouvement indéfiniment, même si ses déplacements échappent à notre perception à notre échelle. Cette réflexion souligne l’importance de considérer les dimensions invisibles de notre réalité et combien la réduction de notre stature, même imaginaire, peut nous aider à l’appréhender.
Bien entendu, cette deuxième expérience est plus réaliste, car elle ne fait pas intervenir une réduction de la stature de la sonde. Cependant, elle présente l’expérience sous un jour différent. Là où la réduction constante de la stature de l’EterniGo nous permet de mieux appréhender l’idée d’un parcours fait d’une réduction sans fin de la vitesse sans arriver à un arrêt, cette seconde expérience montre qu’il est plus difficile d'accepter cette notion sans réduction de la stature.
Ainsi, la réduction de celle-ci est simplement un moyen de réaliser que, dans cette réalité, quelle que soit la distance parcourue, sa progression demeure infinie, même si elle est microscopique et invisible.
Recherche sur “l’expérience mural”
L’expérience murale sert à imaginer ralentir l’expérience du PÉMR proportionnellement aux nouvelles moitiés restantes parcourues afin de mieux se rendre compte du problème du PÉMR, et c’est la première utilité de cette expérience de pensée. Elle utilise l’illusion du mouvement par l’épuisement des TMPT pour exploiter le mouvement, qui est censé être une illusion dans le PÉMR pour comprendre l’éternité du PÉMR. En ce sens, cette expérience est tout de même limitée à nos capacités sensorielles, limitées aux TMPT, puisqu’elle s’appuie sur cette limitation pour nous faire percevoir l’éternité du PÉMR.
Ainsi, la réduction de la distance effective entre le mur et l’EterniGo diminue indépendamment de la réduction de notre stature. Mais il n’est pas sûr que ce rapprochement devrait exister si nous avions pleinement conscience de l’éternité en dehors des TMPT.
De ce fait, l’expérience murale ne permet de percevoir que partiellement la réalité de l’éternité. Que serait alors cette réalité “A”, “B”, “C” dans le PÉMR si nous avions pleinement conscience de cette action dans la 6D ? Difficile de se projeter dans cette question, puisque ni le “passé 6D” ni le PÉMR en dessous des TMPT ne nous sont connus.
L’expérience murale utilise l’illusion supposée du “temps”, due au manque de nos TMPT, pour créer une représentation 4D de l’éternité du PÉMR.
Mais cette représentation en 4D est assurément imparfaite. Elle est utile pour prendre conscience de l’éternité du PÉMR, mais complètement incapable de révéler ce que ce PÉMR signifie endroitiquement dans la 6D.
Spéculation de phénomènes inattendus en physique quantique
La deuxième utilité de cette expérience est de réfléchir aux limites quantiques qui pourraient se manifester de façon inattendue durant son déroulement.
En physique quantique, le concept de quantum d’action minimum se réfère à la plus petite quantité d’énergie ou d’action qui peut être quantifiée, représentée par la constante de Planck (h). Ce principe suggère que certaines grandeurs physiques, comme l’énergie, ne peuvent être divisées à l’infini et sont quantifiées en unités discrètes. Dans "l'expérience murale", à mesure que la sonde ralentit en traversant les moitiés restantes, elle pourrait atteindre des distances si petites qu'elles dépasseraient même la longueur de Planck, une échelle où les lois classiques cessent de s'appliquer et où les effets quantiques prennent le dessus.
Si la vitesse n'est actuellement pas considérée comme quantifiée en mécanique quantique, cette expérience pourrait potentiellement apporter des éclaircissements sur ce sujet. Si l’on suppose qu'à une certaine échelle la vitesse devient également quantifiée, cela soulèverait de nouveaux paradoxes. La sonde, en ralentissant indéfiniment, pourrait atteindre une échelle si petite que la granularité de l’espace-temps empêcherait une réduction continue de sa vitesse. Elle pourrait alors être contrainte de s'arrêter, non par une impossibilité mécanique, mais en raison d'une limite fondamentale imposée par le quantum d’action minimum.
Ce paradoxe est intéressant : si le mouvement de la sonde s'arrête avant qu'elle ne touche le mur en raison de cette limite, l'espace restant entre elle et le mur serait si petit qu'il ne permettrait plus d’effectuer une nouvelle action mesurable. Où se situerait alors la sonde dans cet espace ? Cela évoque le Principe d'incertitude d'Heisenberg, qui limite la précision avec laquelle on peut connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule, bien que ce principe s’applique généralement aux particules subatomiques et non aux objets macroscopiques comme notre sonde. Cependant, si les moitiés restantes sont de nature subatomique, on pourrait spéculer que ces dernières soient régies par une hypothétique granularité de l'espace-temps, impactant ainsi le mouvement de la sonde.
Une telle expérience pourrait ouvrir la voie à une réflexion sur l'existence d’un quantum d’action du mouvement, mettant en lumière les tensions entre les concepts classiques d’espace et de mouvement et les réalités quantiques. Cela remettrait fondamentalement en question notre compréhension de la continuité du mouvement à l'échelle quantique.
L’omnilocation
"L'expérience murale" pourrait-elle répondre à ces questions ? Est-il possible que la sonde soit omnilocatisée, à la fois sur son point de départ, son point d'arrivée, et sur toutes ses positions intermédiaires ?
Cette hypothèse, bien que spéculative, pourrait toucher à des phénomènes observés en physique quantique, tels que la superposition d'états. En mécanique quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément, et ce n’est qu’au moment de l’observation ou de la mesure que leur position ou leur état est fixé. Appliquer cette idée à un objet macroscopique, comme la sonde dans "l'expérience murale", remettrait en question notre compréhension classique de la localisation et du mouvement.
Si la sonde ralentit au point de franchir des seuils de plus en plus petits, en atteignant peut-être des dimensions proches de la longueur de Planck, elle pourrait théoriquement entrer dans un régime où les effets quantiques deviennent dominants.
Dans ce cas, les moitiés restantes ne seraient plus réduites de façon classique, mais bloquées par cette quantification de l’espace-temps, créant une sorte de barrière quantique. La sonde ne pourrait plus avancer parce qu’il n’y aurait plus d’espace suffisamment divisible pour le permettre. L’effet quantique viendrait alors de l’espace lui-même, suggérant une nature granulaire de l’espace-temps, et non continue, à de très petites échelles.
Cela poserait un paradoxe : la sonde pourrait se retrouver dans une superposition de positions, incapable d’atteindre la fin de son parcours, non par limitation de vitesse, mais par la structure quantique de l’espace. Pour toutes ces raisons, “l’expérience murale” pourrait apporter de nombreuses réponses aux questions et trancher sur la question de l’existence d’un quantum d’action minimum en physique du mouvement.
Si l’objet macroscopique échappe aux effets quantiques et maintient un mouvement continu sans fin, alors “l’expérience murale” pourrait demeurer valide indéfiniment. En revanche, si l’espace parcouru devient quantique, le mouvement serait soumis aux incertitudes et aux quantifications de la mécanique quantique, rendant l’expérience moins prévisible et potentiellement limitée dans sa continuité.
Chapitre suivant